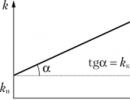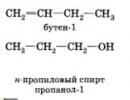Caractéristiques du système des partis. Philippines : histoire, population, gouvernement et système politique Philippine Democratic Party People's Power
Nom officiel- République des Philippines (Republika cg Pilipinas, République des Philippines). Ils sont situés sur 7107 îles de l'archipel des Philippines au sud-est du continent eurasien. La superficie est de 300,8 mille km2, la population est de 84,5 millions de personnes. La langue officielle est le philippin ; les langues officielles sont le philippin et l'anglais. La capitale est le Grand Manille, depuis 1975, elle se compose de Manille elle-même et de 16 villes satellites avec une population de 9,2 millions d'habitants. (2002). Jour férié - Jour de l'Indépendance 12 juin (depuis 1970). L'unité monétaire est le peso (égal à 100 centavos). Les Philippines revendiquent la propriété de 8 îles de l'archipel des Spratleys en mer de Chine méridionale.
Membre de l'ONU (depuis 1945) et de ses comités et organisations, ainsi que du FMI, de la BIRD, de l'APEC, de l'ASEAN (1967), etc.
Sites touristiques des Philippines
Géographie des Philippines
Situé entre 21°25' et 4°23' de latitude nord et 116°40' et 127° de longitude est. Ils sont baignés par les eaux de l'océan Pacifique et de la mer de Chine méridionale. À 100 km de l'archipel dans l'océan Pacifique se trouve la fosse des Philippines avec une profondeur de 10 789 m.Le littoral est d'env. 18 000 km sont en retrait, il y a peu de bons ports. Les plus grandes îles sont Luzon (105 000 km2) et Mindanao (95 000 km2). Toutes les frontières sont maritimes : avec le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie et l'île de Taïwan. Plus des 3/4 du territoire des Philippines - montagnes et collines. Le plus grand système montagneux est la Cordillère centrale (avec le point culminant de 2934 m) sur l'île de Luzon. Le point culminant des Philippines est le volcan Apo (2954 m) sur l'île de Mindanao. Basses terres - bandes étroites le long des côtes ou le long des cours d'eau. Les plus grandes plaines sont la Central, ou Manille, sur l'île de Luzon et Cotabato sur l'île de Mindanao. Il y a peu de lacs, les plus grands sont Laguna de Bai, Taal et Lanao. Saint-400 rivières, pour la plupart petites, elles sont rapides et orageuses ; les plus grands - Cotabato (550 km) et Cagayan (350 km) sont navigables dans le cours inférieur. 5 mers inter-îles - Sibuyan, Samar, Visayan, Kamote et Mindanao (la dernière la plus profonde - 1975 m). Les sols latéritiques prédominent. Parmi les 10 000 espèces végétales, plus de 9 000 sont supérieures, 40% des espèces sont endémiques, 5,5 millions d'hectares sont couverts de forêt. La faune est particulière : un grand pourcentage d'endémiques, pas de grands mammifères, plus de 450 espèces d'oiseaux. Les mers sont riches en poissons - plus de 2 000 espèces ; la nacre et les perles sont obtenues à partir de certains coquillages. Grands gisements de minerai de cuivre (réserves probables en métal 9,2 millions de tonnes), chromites (10-15 millions de tonnes), minerai d'or (14 millions de tonnes), fer (590 millions de tonnes), nickel (3 millions de tonnes en métal). Les ressources en carburant et en énergie ne répondent pas aux besoins du pays, le pétrole est importé. Le climat est de type mousson tropicale maritime. Les précipitations annuelles sont de 1000 à 4500 mm, la température annuelle de l'air est d'env. +27°С avec une amplitude de fluctuation de 2-4°С. L'archipel est sujet aux typhons.
Population des Philippines
Depuis les années 1970 la population a doublé et le taux de croissance annuel est passé de 2,9 % à 1,1 %. Mortalité infantile 31 personnes pour 1000 nouveau-nés (2001). 59% de la population totale vit dans les villes. Il y a un peu plus d'hommes que de femmes. L'espérance de vie moyenne est de 69 ans. La population est jeune. Près de 95 % de la population âgée de plus de 15 ans est alphabétisée. Plus de la moitié des Philippins parlent anglais.
La population est polyethnique - jusqu'à 100 groupes ethniques ; grand - Bisayans (1/3 de la population), Tagals (1/4 de la population; jouent un rôle de premier plan dans la vie du pays), Ilokans, Bikols. La population indigène est anthropologiquement homogène, appartient à la variété sud-asiatique de la race mongoloïde, parle près de 100 langues apparentées (le groupe philippin de la branche occidentale de la famille des langues austronésiennes). Parmi les petites nationalités, se distinguent les Aeta, ou Negrito - les descendants des aborigènes négro-australoïdes de la race équatoriale. Parmi les non-autochtones, les Chinois prédominent. Selon la Constitution, l'Église est séparée de l'État, la liberté de religion est confirmée. La grande majorité de la population est chrétienne, dont St. 80% sont catholiques (ils ont été convertis au catholicisme par les Espagnols au 17ème siècle), plus de 5% sont protestants, 5-6% sont musulmans, env. 2% - animistes, etc.
Histoire des Philippines
De l'Antiquité au début de l'expansion européenne (le dernier quart du XVIe siècle), les Philippines étaient une partie périphérique de l'espace culturel et historique malais-indonésien. Depuis les années 1580 con. années 1890 Philippines - une colonie d'Espagne, libérée de la dépendance coloniale à la suite de la révolution nationale de 1896-98. Avec la victoire des rebelles en 1898, la Première République indépendante est formée et la Constitution démocratique de 1898 est adoptée. La même année, aux termes du Traité de paix de Paris, qui met fin à la guerre hispano-américaine de 1898, les Philippines devient une colonie des États-Unis. Depuis 1901 et presque tout le 1er étage. 20ième siècle Les Philippines sont une colonie des États-Unis, qui ont proclamé un cours libéral pour préparer les Philippins à l'autonomie (en particulier, ils ont introduit un système d'élections et de partis depuis 1907). Depuis 1934, les États-Unis ont introduit un régime d'autonomie aux Philippines - une "période de transition" de 10 ans avant la pleine souveraineté. La Constitution a été adoptée en 1935 et le président philippin M. Quezon (1935-44) a été élu. En 1941-45, les Philippines ont survécu à l'occupation japonaise. Après l'expulsion des envahisseurs (printemps 1945) - le début de la décolonisation. En avril 1946 - élection du premier président des Philippines indépendantes - M. Rojas (1946-48), protégé des États-Unis, homme politique d'obédience extrêmement conservatrice. Le modèle américain de décolonisation, qui porte atteinte à bien des égards à la souveraineté des Philippines, ne convient pas à la majorité des Philippins. La tension sociale a abouti à une sanglante guerre paysanne de 1948-53, menée par les communistes. Le rôle décisif dans la défaite du soulèvement a été joué par R. Magsaysay, à partir de 1950 - ministre de la Défense, puis président des Philippines (1954-57). Tout R 1950 - ser. années 60 aux Philippines, une sorte de démocratie « oligarchique » de façade s'est instaurée (le vrai pouvoir est entre les mains de plusieurs clans de propriétaires terriens qui ont manipulé les lois et les institutions démocratiques). Depuis 1965, le président des Philippines, F. Marcos, a été réélu en 1969. En septembre 1972, il a instauré l'état d'urgence aux Philippines, établissant un régime de pouvoir personnel. Ses plans de modernisation accélérée n'ont pas été mis en œuvre en raison de la croissance de la corruption, du kronisme et de la crise économique (tournant des années 1970 et 1980). En février 1986, la dictature a été détruite à la suite d'actions massives et sans effusion de sang à Manille d'opposants à l'autoritarisme (la révolution du "pouvoir du peuple"). Pour la première fois dans l'histoire des Philippines, une femme est devenue présidente - K. Aquino (1986-92). En 1987, une constitution démocratique a été adoptée. Sinon, l'approfondissement de la crise de l'économie et la déstabilisation se sont poursuivis. Les élections de 1992 sont remportées par F. Ramos (1992-98), le seul des dirigeants « post-autoritaires » qui réussit à stabiliser la situation. Contrairement au réformateur Ramos, les élections de 1998 ont été remportées par un populiste, un ancien acteur de cinéma J. Estrada, qui a été reconnu coupable de corruption et évincé du pouvoir en 2000 (révolution du Pouvoir populaire-2). Depuis janvier 2001, la présidente des Philippines est redevenue une femme politique, G. Macapagal-Arroyo. Son gouvernement a reçu un lourd héritage de J. Estrada, et jusqu'à présent, les tentatives d'améliorer l'économie et de reprendre le cours de la modernisation ont été inefficaces.
Structure de l'État et système politique des Philippines
Les Philippines sont un État unitaire démocratique, une république avec une forme de gouvernement présidentiel. La Constitution adoptée en 1987 est en vigueur. Administrativement, les Philippines sont divisées en provinces (73), réunies en 17 régions administratives et économiques, municipalités, barangays (districts ruraux). Grandes provinces : Pampanga, Rizal, Quezon, Ilocos (Nord et Sud), Cebu, Iloilo, Maguindanao, etc. Grandes villes : Grand Manille, Davao, Cebu, Iloilo, etc.
Les principes de l'administration publique reposent sur l'élection des organes gouvernementaux et la séparation de ses pouvoirs - législatif, exécutif, judiciaire. L'organe suprême du pouvoir législatif est le Congrès bicaméral. La chambre haute - le Sénat (24 sénateurs âgés d'au moins 35 ans), est élue pour 6 ans avec des élections intermédiaires tous les 3 ans et le droit de réélection pour un second mandat. Le chef de la chambre haute est le président du sénat, qui est élu par les sénateurs. La Chambre des représentants (chef - président) est élue pour 3 ans, composée de 250 députés au maximum (à partir de 25 ans) avec un droit de réélection pour 3 mandats. Le président des Philippines détient le pouvoir exécutif suprême (l'âge d'élection n'est pas inférieur à 40 ans, résidence aux Philippines depuis au moins 10 ans avant l'élection). Le président (et avec lui le vice-président) est élu pour 6 ans sans droit de réélection pour un second mandat. En même temps, il est chef de l'État, du gouvernement (forme un cabinet responsable devant lui), commandant suprême. Le président ne peut pas dissoudre le parlement, mais a le droit de veto lorsque les projets de loi sont adoptés par le congrès. Dans des situations extrêmes, le président a le droit de déclarer l'état d'urgence pour une période limitée par le Congrès.
Les Philippines ont le suffrage universel pour tous les citoyens à partir de 18 ans. Le système électoral des Philippines est de type mixte, comprenant des éléments du système majoritaire (élection du président - vice-président, ainsi que des sénateurs au scrutin secret direct de l'électorat panphilippin) et un système proportionnel modifié. Des éléments de cette dernière sont présents lors des élections à la chambre basse (principe de la représentation proportionnelle dans le vote par circonscriptions et listes de partis). La préservation dans le système politique des Philippines des stéréotypes de la culture politique traditionnelle (clan en politique, système de liens verticaux paternalistes, etc.) a un impact négatif sur le système électoral. Les Philippines font partie des pays en développement avec un taux constamment élevé de violations de la loi électorale - la pratique du commerce des votes, la fraude électorale, la pression d'en haut sur l'électorat, les flambées de violence ouverte, etc.
Présidents remarquables : Président des Philippines autonomes - M. Quezon (1935-44), connu pour le phénomène unique de popularité de masse, combiné à un style de gouvernement dur, pro-américanisme et anticommunisme ; F. Marcos (1965-86), qui a échoué au programme de modernisation, mais mérite l'attention en réorientant la politique étrangère pro-américaine unilatérale des Philippines vers l'élargissement de la coopération et du partenariat avec les États asiatiques ; F. Ramos (1992-98), pragmatique et intellectuel qui a réussi la modernisation économique et la stabilisation de la société sans briser les structures démocratiques et les ordres juridiques.
Les autorités locales - gouverneurs de provinces, maires de villes, assemblées législatives provinciales, conseils municipaux - sont formées sur la base du même système d'élections que les plus hautes autorités. Les principes de la gestion décentralisée ont été introduits localement, les autorités ont été dotées de larges pouvoirs en matière de politique budgétaire, fiscale, etc. Leurs activités sont contrôlées par le Congrès (une source de corruption parmi les membres du Congrès et les dirigeants locaux).
Les Philippines se caractérisent par un multipartisme informe, qui comprend de fragiles conglomérats de partis de type traditionnel (associations autour de leaders, pas de programmes). Les deux principaux partis du passé - les nationalistes (fondés en 1907) et les libéraux (fondés en 1946) - n'ont pas pu se consolider après avoir été dispersés pendant les années d'autoritarisme, à l'heure actuelle ce sont des formations et des factions faibles à la fois pro-gouvernementales et coalitions et blocs d'opposition. La coalition pro-présidentielle « Lakas » (« Pouvoir du peuple ») réunit plusieurs partis et blocs, incl. tels que "l'Union nationale des démocrates-chrétiens", "Lutte pour la démocratie philippine", "Parti du développement provincial", etc. Les opposants à "Lacas" - "Parti des masses" de l'ex-président Estrada, "Parti réformateur du peuple", etc. Le flanc gauche de l'opposition - le "Parti des travailleurs" légal (fondé en 2001) avec un programme de formes pacifiques de lutte pour les intérêts des travailleurs. Gauche radicale illégale, opérant à partir de con. années 1960 Parti communiste des Philippines (à gauche), dirige la guérilla armée de la "Nouvelle armée populaire" et fait partie du "Front national démocratique".
Organisations professionnelles de premier plan : chambres de commerce et d'industrie des Philippines ; Fédération des chambres de commerce et d'industrie philippino-chinoises.
Les éléments actifs de la société civile sont les organisations non gouvernementales (ONG), leur développement est encouragé par l'État, notamment, sous forme de soutien financier. Domaines d'activité des ONG - sécurité environnement, travailler pour améliorer la vie des paysans, etc. Participer à la politique : aux élections et en tant qu'organisateurs de manifestations pacifiques de masse à orientation pro et anti-gouvernementale. Les organisations altermondialistes sont en train de se former, elles adhèrent à la tactique des actions non-violentes. Principales ONG aux Philippines : Village Transformation Movement, Green Forum, etc.
Les principales tâches dans le domaine de la politique intérieure des Philippines sont la mise en œuvre de la modernisation économique comme base de stabilisation de la société; consolidation de l'élite politique autour du programme de réforme présidentielle, suppression de l'opposition, notamment de ses mouvements extrémistes. Aucune de ces tâches n'est effectuée. Les critiques du président Arroyo pour son indécision dans la lutte contre la corruption, le kronisme, son incapacité à résoudre le problème de la pauvreté et à éliminer le foyer de violence dans le Sud musulman proviennent non seulement de ses opposants, mais aussi de son entourage (représentants de la classe moyenne , la direction de l'Église catholique, l'élite militaire). L'état politique interne des Philippines reste incertain et instable.
La formation de la politique étrangère des Philippines et l'adoption des décisions de politique étrangère sont concentrées entre les mains du président (autorité maximale), du ministère philippin des Affaires étrangères, de son chef (souvent aussi le vice-président), du Conseil de sécurité et du Agence nationale de coordination du renseignement. En vertu de la Constitution de 1987, le rôle du Congrès dans l'orientation de la politique étrangère a été renforcé (les accords internationaux n'entrent en vigueur qu'après avoir été ratifiés par les 2/3 des membres du Sénat). Depuis la présidence de Marcos, la politique étrangère des Philippines est fondée sur la subjectivité dans les relations internationales, la priorité des tâches de garantie des intérêts nationaux, l'indépendance et le multilatéralisme de la diplomatie. Avec le système multipolaire des relations de politique étrangère des Philippines, une attention particulière est accordée à la participation égale et active aux affaires régionales et aux nouveaux processus d'intégration dans la région du SCEE. Dans le même temps, l'élite politique des Philippines n'a jamais été confrontée à la question d'abandonner la priorité des relations avec les États-Unis (fragilisés au début des années 1990 après le retrait des bases militaires américaines des Philippines) comme garant de sécurité régionale et nationale. Sous le gouvernement Arroyo, la présence militaire américaine dans l'archipel a été rétablie, jusqu'à présent dans un format qui ne viole pas la Constitution des Philippines. Alors que les États-Unis plaçaient les Philippines dans une zone de terrorisme international, Arroyo a fait venir des conseillers militaires américains et des experts en contre-terrorisme pour aider les troupes locales dans les opérations contre les séparatistes musulmans. La montée du pro-américanisme dans la politique étrangère des Philippines inquiète leurs partenaires de l'ASEAN (en particulier les pays musulmans) et provoque une montée de l'antiaméricanisme chez les Philippins, qui craignent la possibilité d'une participation directe des Américains à des opérations militaires (en violation de la Constitution). Pendant ce temps, le Sud musulman est encore loin de la paix. L'une des raisons est le faible professionnalisme et l'équipement technique obsolète de l'armée philippine, la plus faible des pays de l'ASEAN. L'armée aux Philippines est régulière, formée en partie sur la base du service militaire obligatoire (à partir de 20 ans), en partie à partir de personnes embauchées pour 3 ans sous contrat. Il se compose des forces terrestres, de l'armée de l'air et de la marine. Le nombre total est inférieur à 200 000 personnes. La Constitution fixe la priorité du pouvoir civil sur les forces armées, les militaires ne peuvent pas s'engager dans les affaires et la politique (sauf pour la participation aux élections). Mais parmi une partie du corps des officiers, le mécontentement face à l'inefficacité de la politique de l'État gronde, de sorte que les tentatives de conspirations militaires et de rébellions ne sont pas exclues (de tels précédents se sont déjà produits pendant les années de K. Aquino).
Les Philippines entretiennent des relations diplomatiques avec la Fédération de Russie (établie avec l'URSS en 1976).
Économie des Philippines
Les Philippines sont l'une des cinq économies les plus avancées d'Asie du Sud-Est, connues sous le nom de "tigres asiatiques" de la deuxième vague. La politique économique de tous les gouvernements de la période d'indépendance reflétait la nature du régime politique, par exemple, autoritaire sous F. Marcos, "nouvelle démocratie" sous C. Aquino, F. Ramos, G. Arroyo. Les Philippines, plus tardives que les autres États des "cinq" (cela comprend, outre les Philippines, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie), ont commencé à moderniser leur économie. Le pays a subi plusieurs graves crises économiques et sociopolitiques, qui ont fortement affaibli l'économie et entravé sa modernisation. A augmenté depuis 2000 impact négatif aux Philippines, une récession de l'économie mondiale, en particulier aux États-Unis, et une aggravation de la situation socio-politique dans le pays lui-même, incl. soulèvements armés séparatistes dans les zones musulmanes du Sud. La restructuration de l'économie est entravée par la bureaucratie corrompue et la gestion des soi-disant. couronnes ou "amis". D'importantes réformes économiques restent largement sur le papier.
Depuis les années 1970 Les Philippines ont commencé à prendre du retard sur les autres en termes de croissance économique de plus pays développés Asie du sud est. En 2003, le taux de croissance économique a augmenté à 4,5%, et le volume du PIB - jusqu'à 80 milliards de dollars américains.
Dans la consommation du PIB, la part de la consommation personnelle est la plus élevée : en 2001, elle s'élevait à 2561,2 milliards de pesos, dépassant 5,8 fois les dépenses publiques et 4,1 fois l'épargne brute. Le revenu national brut par habitant en 2001 s'élevait à 1 050 dollars américains et plus d'un quart de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté. La plupart de ce groupe se trouve dans les zones rurales. Un problème aigu reste une forte inégalité dans la répartition des revenus. Inflation 4,5 % (2003).
3/4 de la population active, soit 32,5 millions de personnes, était la population active, incl. 29,4 millions avaient un emploi et 3,1 millions étaient au chômage. Avec une augmentation du niveau technologique de la production, la qualité des indicateurs du travail change - le nombre de spécialistes qualifiés augmente. La législation du travail est en vigueur à partir du con. années 1980 et ne s'applique qu'à une minorité de la population active - les membres des syndicats. Il détermine les questions salariales, y compris les minima et les indemnités, les heures de travail, etc. Les pensions et autres prestations sont fournies par deux organismes d'assurance, l'assistance chômage est fournie exclusivement par des organisations caritatives.
Structure sectorielle du PIB (1981 et 2001,%) : industrie 39,2 et 31,2, agriculture 24,9 et 15,2, services 35,9 et 53,6.
Dans l'industrie, les changements les plus importants au niveau technique se sont produits dans le plus grand groupe d'industries - l'industrie manufacturière. Mais sa part (ainsi que l'ensemble du secteur industriel) a diminué à 22,4% du PIB en 2001 ; la part de la construction a augmenté à 5,4 %, les services publics à 3 % et l'exploitation minière a diminué à 0,2 %. La structure de l'industrie manufacturière change le plus sensiblement en raison d'une augmentation de la production haute technologie pour l'export.
Dans l'agriculture, le secteur le plus en retard du PIB, 2/3 de la valeur revient à l'agriculture, 1/3 - aux autres secteurs - élevage, aviculture, pêche et sylviculture. Le riz et le maïs, les légumes et les fruits sont principalement cultivés pour le marché local, mais il n'y a pas assez de nourriture propre.
La branche la plus importante du secteur des services est le commerce, qui représentait 14,6% du PIB en 2001, suivi des services personnels et publics - 11,7 et 9,9% respectivement, des autres services (transactions immobilières, transports, communications, économie d'entreposage et transactions financières) - 17,4 %. Le commerce, à la fois en termes de valeur et de nombre d'employés, domine parmi les autres services. Les prix de gros augmentent plus lentement que les prix à la consommation - en 2001, ils ont augmenté à 134,7 points à 1995 = 100, et les prix à la consommation - jusqu'à 149,6 points.
Aux Philippines, pays insulaire et montagneux, une place importante est occupée par le transport de passagers et de marchandises par route et par bateau. Il y a peu de chemins de fer. Le trafic aérien est peu développé. Le système de communication - téléphone, télégraphe et télex - ne satisfait pas les besoins de la population dans ses services. En termes de développement du tourisme étranger - les revenus qu'il en tire et le nombre de touristes - les Philippines sont loin derrière les pays les plus avancés économiquement d'Asie du Sud-Est. En 2002, le nombre de touristes en provenance des États-Unis, du Japon, de Chine, de l'UE, d'Australie et d'autres pays était d'env. 3 millions de personnes
La banque centrale, créée en 1949, gère et contrôle le système de crédit et financier. Elle gère les réserves d'or et de change, maintient le taux de change du peso, effectue des opérations de change, contrôle les opérations des banques commerciales et exerce d'autres fonctions. Le système de crédit et financier est dominé par les banques commerciales. Le volume des ressources des banques de développement, d'épargne et agricoles, d'assurance est bien moindre. L'usure persistait dans les zones rurales. Les prêts et crédits nationaux et étrangers sont l'une des principales formes de financement du développement économique des Philippines. Le marché national des capitaux est peu développé. Le rôle des bourses (Manille, Makati, Metropolitan) dans la mobilisation du capital reste insignifiant. Le gouvernement utilise largement le crédit de l'État pour couvrir le déficit budgétaire de l'État. Les emprunts extérieurs entraînent une augmentation de la dette extérieure, qui était en 2001 de 73,3%, soit 2/3 du PIB, avec des réserves de change de 13,44 milliards de dollars américains et des réserves d'or de 2,2 milliards de dollars américains, soit 4 fois plus que les leurs. Les réserves nettes de change en mai 2003 étaient de 12,5 milliards de dollars.
Le système monétaire actuel a été introduit avec la création d'une banque centrale, qui s'est vu attribuer le droit de contrôler la circulation monétaire et le droit de monopole d'émettre de l'argent contre la sécurité des réserves de change, des effets de commerce, des titres d'État, etc. La structure de la circulation monétaire est dominée par la monnaie de dépôt. Au début 2002 sur les 2139,0 milliards de pesos en circulation, ils représentaient 1746,8 milliards de pesos, en espèces - 392,25 milliards.
Dans les finances publiques, une place particulière est occupée par le budget de l'État, dont la base est le budget central. Il finance les budgets locaux. La majeure partie des revenus est constituée de recettes fiscales. Les dépenses servent principalement à financer le développement social et économique. Le budget de l'État pour la plupart est réduit à un déficit, en particulier de la con. années 1990 Les revenus en 2001 se sont élevés à 561,9 milliards de pesos, les dépenses - 706,4 milliards soit. le déficit représentait près de 150 milliards de pesos. En 2002, il est passé à plus de 200 milliards de pesos, soit 3,3 % du PIB. En 2003, il devait atteindre 4,7 % du PIB. Utilisant pour couvrir le déficit, en plus des emprunts des banques centrales et commerciales, des emprunts des banques internationales institutions financières et les États individuels entraînent une augmentation de la dette extérieure.
Les relations économiques extérieures des Philippines se concentrent sur les États-Unis, le Japon, la Chine (y compris Hong Kong), les pays de l'UE, l'Australie et, dans une moindre mesure, sur les pays d'Asie du Sud-Est. Les investissements directs étrangers proviennent principalement de multinationales américaines et japonaises. Après la crise de 1997-98, ils ont considérablement baissé. L'assistance (prêts et crédits) est fournie par les organisations financières internationales - le FMI, le Groupe de la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, ainsi que les gouvernements des États individuels et les institutions privées.
Le taux de croissance du commerce extérieur dépasse le taux de croissance du PIB. Dans les relations commerciales extérieures (biens et services) des Philippines, le commerce avec les États-Unis, le Japon, la Chine, les pays de l'UE, l'Australie prévaut et les pays d'Asie du Sud-Est - avec Singapour. L'exportation de biens et de services (en 2002, elle s'élevait à 35,2 milliards de dollars américains, soit près de la moitié du PIB du pays) était dominée par l'exportation de biens. De Ser. années 1980 les composants électroniques occupent la première place dans les exportations de marchandises : en 2001, sur 31,2 milliards de dollars américains, ils représentaient 16,8 milliards. Parmi les exportations traditionnelles, ses principaux articles sont : les produits du cocotier, la fibre d'abaca, le sucre brut, les concentrés de cuivre. Les importations de marchandises en 2002 se sont élevées à 35,5 milliards de dollars; la moitié de sa valeur est tombée sur les biens d'équipement et 1/10 - sur les combustibles et les matières premières énergétiques, principalement le pétrole. Le reste des importations était dominé par les denrées alimentaires (céréales).
Suite à la crise monétaire et financière de 1997-98, la monnaie nationale a été fortement dévaluée. Le taux de change du peso par rapport au dollar américain a largement dépassé le niveau d'avant la crise. 1 dollar américain équivaut à 53,5 pesos (juin 2003).
Science et culture des Philippines
Dans le domaine scientifique, le Conseil national de la recherche des Philippines et l'Administration nationale des sciences sont les centres de coordination les plus importants. De Ser. années 1970 le Centre philippin de recherche fondamentale de l'Université des Philippines fonctionne, coordonnant les activités scientifiques de diverses universités et autres institutions scientifiques. Le Centre participe à l'élaboration de programmes étatiques pour le développement de la science. Les principales sources de financement de la science sont le budget de l'État et l'aide des gouvernements des différents pays et des organisations internationales. La recherche pratique est effectuée principalement dans les grandes entreprises. Les principales universités sont l'Université d'État des Philippines, les universités privées sont l'Université St. Thomas, Manille Ateneo, l'Université Silliman. La science manque de fonds pour la financer.
L'éducation est dirigée par le ministère de l'Éducation et de la Culture. Les établissements publics d'enseignement supérieur sont régis par des conseils de régents. L'enseignement primaire est public, obligatoire et gratuit. L'école secondaire est à 95% privée, l'école supérieure à 80%. Le manque de financement public du système éducatif entrave son développement. Près de 84% des dépenses publiques d'éducation vont à l'école primaire, env. 15% - au secondaire et 1% - au supérieur. En 2002, environ 15 millions d'enfants âgés de 7 à 12 ans étudiaient à l'école primaire, 6 millions à l'école secondaire et St. 2,5 millions
Pendant une longue période (près de 400 ans), les Philippines ont été l'objet d'une occidentalisation, qui a eu un impact profond sur le développement de la culture spirituelle, dans laquelle les valeurs culturelles étrangères apportées de l'Occident ont été partiellement rejetées, partiellement assimilées par les Philippins. selon leur vision du monde et leur expérience esthétique. La culture spirituelle moderne des Philippines est marquée par la croissance du "nationalisme culturel", la recherche d'identité et d'identité culturelle des Philippins. La Constitution philippine définit la culture nationale comme "l'unité dans la diversité". L'État encourage la liberté de création, soutient les personnalités culturelles et les associations créatives par un système de subventions, de bourses, etc. à l'extérieur du pays. Ses œuvres littéraires et son journalisme ont eu une influence décisive sur le développement de l'identité nationale des Philippins, bien qu'il ait écrit principalement en espagnol. La littérature philippine moderne est riche en noms, genres, tendances. La littérature de langue anglaise et de langue tagalog se distingue par l'ampleur et la profondeur du sujet, le style hautement artistique (la littérature en langues régionales se développe également). De nombreuses œuvres d'écrivains et de poètes écrivant en anglais et en tagalog sont publiées aux États-Unis et en Europe, y compris en Russie. Les grands noms de la prose de langue anglaise sont N.V. Gonzalez, Nick Joaquin, les poètes H. Lansang Jr., R. Tinio, F. Cruz et bien d'autres. La plus grande figure de la littérature en langue tagalog est le poète et nouvelliste A.V. Hernandez (1903-70), sur les œuvres duquel des générations d'écrivains modernes ont été élevées. Les Espagnols ont également noté le don inhabituel des Philippins dans les arts visuels, leur sens particulier de la couleur (les couleurs des tropiques). Arts visuels des Philippines du XXe siècle. jusqu'à nos jours, il absorbe une variété d'influences: de l'académisme, du réalisme, de l'impressionnisme, de l'abstractionnisme, de divers types de mouvements d'avant-garde modernes à une sorte de primitivisme philippin. Les noms les plus célèbres des arts visuels des Philippines: les artistes C. Francisco, V. Manansala, A. Luz, Anita Magsaysay-Ho, les sculpteurs N. Abueva, S. Saprid et d'autres L'histoire du pays se reflète dans la architecture des villes philippines : chaque époque a laissé ses symboles (baroque espagnol des XVIe-XVIIe siècles, néoclassicisme du début du XXe siècle, constructivisme des années 1930, gratte-ciel modernes des quartiers d'affaires, par exemple Makati dans le Grand Manille). Les architectes philippins les plus célèbres des années 1970-90. - L. Loksin, S. Consio.
Quatre étapes peuvent être distinguées dans l'histoire post-coloniale des Philippines : 1945-1954 - la décolonisation, la version philippine ; 1954-1965 - la formation et l'autodestruction progressive du modèle philippin d'après-guerre de démocratie élitiste ; 1965-1986 - formation, stabilisation et effondrement du régime autoritaire ; depuis février 1986 (étape historique - la soi-disant révolution du "pouvoir du peuple") - une période de développement post-autoritaire, de redémocratisation et de modernisation dans des conditions mondiales et régionales modernes. Ainsi, le processus de décolonisation aux Philippines a commencé dès 1945, immédiatement après l'expulsion des occupants japonais du pays dans une atmosphère de poussée patriotique à l'échelle nationale. Cependant, la liesse générale à l'entrée dans l'Archipel de l'armée d'invasion américaine commandée par le général Douglas MacArthur, très populaire aux Philippines61, fait rapidement place à la déception face aux préparatifs de l'indépendance de la colonie américaine. La vision du monde, le comportement et les émotions des Philippins ont été influencés par un changement significatif du climat moral et psychologique dans le pays qui s'est produit avec la fin de l'occupation japonaise. Malgré la sévérité des formes d'oppression coloniale les plus cruelles et les plus sanglantes qu'ont connues les Philippines, la facilité avec laquelle le Japon s'est emparé des vastes territoires de l'Asie de l'Est et du Sud-Est fragilisés aux yeux des habitants des îles (ainsi que d'autres peuples du région) le prestige des puissances occidentales, symbolisant la victoire de l'Est sur l'Ouest. Pour la première fois, les Philippins, soumis à une occidentalisation prolongée, avaient un sentiment d'identité asiatique, d'appartenance au monde de l'Asie, ce qui a inévitablement conduit à la croissance de sentiments anti-impérialistes, à la montée du nationalisme et au désir d'une complète et rapide libération de la dépendance coloniale. Dès les premiers pas de la décolonisation, les Américains tentent de restaurer les positions dominantes de l'élite locale d'avant-guerre (l'élite foncière, parmi laquelle se forment des « empires économiques » dépendant du marché américain, des clans politiques et des dynasties). Les États-Unis s'apprêtaient à transférer le pouvoir souverain sur les Philippines à cette partie très conservatrice de la société. Dès lors, le comportement de D. MacArthur, qui se tenait à l'origine de la décolonisation, est également compréhensible. Il a complètement ignoré les revendications des anciens membres de la Résistance (non seulement de gauche, mais aussi des libéraux issus du milieu de l'intelligentsia créative et scientifique, des étudiants, d'une partie des cercles d'élite et des hommes d'affaires) pour une large démocratisation et des réformes économiques radicales. Vis-à-vis du flanc gauche des forces politiques, il fait preuve d'une intolérance ouverte. L'organisation Hukbalahap (Armée populaire anti-japonaise) dirigée par le Parti communiste a été dissoute et les Huks (combattants de la guérilla) ont été déclarés éléments subversifs. Au final, parmi la « vieille oligarchie »62, les Américains ont choisi un candidat au poste de premier président des Philippines indépendantes. Il s'agit de Manuel Rojas (1946-1948), homme politique de la génération d'avant-guerre, issu de l'élite foncière, homme aux vues extrêmement réactionnaires (ouvertement pro-fasciste dans les années 1930), collaborateur bien connu pendant l'occupation , qui ne cachait pas ses contacts étroits avec les Japonais. En d'autres termes, une personnalité politique, peu attrayante à tous égards pour une grande partie des Philippins. Le mouvement social massif aux Philippines pour l'octroi immédiat de la pleine indépendance politique et économique a forcé les Américains à prendre des décisions rapides. Dans la situation de l'époque, M. Rojas semblait répondre aux exigences des États-Unis : un anticommuniste convaincu qui changeait facilement son orientation pro-japonaise en pro-américaine, un leader fort capable de contenir l'assaut des l'opposition de gauche. Le rival de M. Rojas aux élections de 1946 était Sergio Osmeña, vice-président du gouvernement autonome de M. Quezon (ils dirigeaient ensemble le gouvernement philippin en exil aux États-Unis pendant les années de guerre), originaire de l'influent clan politique de "Osmeña". À partir des années 1920, il se bat continuellement avec M. Quezon pour la première place de l'État, mais en vain, car il ne parvient pas à surmonter le phénomène vraiment unique de la popularité de masse de M. Quezon. Sans la mort de M. Quezon en août 1944 en exil, la question du premier président des Philippines indépendantes aurait apparemment été tranchée en sa faveur. Osmenya, en revanche, était considéré par les Américains comme un leader peu prometteur, incapable de faire preuve d'une forte volonté politique. Osmeña et Rojas étaient tous deux membres de la direction du même parti politique, le Parti des nationalistes (PN), un leader monopolistique en politique depuis sa formation en 1907 avec un système multipartite formel. Peu de temps avant les élections de 1946, Osmeña a rejoint le bloc électoral avec l'Alliance démocratique - l'une des plus grandes organisations publiques de la persuasion libérale, mais extrêmement lâche et hétéroclite dans sa composition. En réponse, Rojas a quitté le parti avec la partie conservatrice de droite des membres du PN, formant son propre Parti libéral (LP). Ce fut le début d'un système bipartite qui dura jusqu'à l'établissement d'un régime autoritaire aux Philippines. Même avec le soutien impressionnant des États-Unis (moral et matériel), M. Rojas aux élections d'avril 1946 réussit à vaincre son adversaire avec une majorité insignifiante de voix. Les Philippins n'ont pas voté pour l'impopulaire Osmeña, mais contre Rojas, le favori des États-Unis, démontrant ainsi des sentiments et des sentiments anti-américains et anti-impérialistes. Un certain nombre d'accords bilatéraux américano-philippins signés avant et immédiatement après l'octroi officiel de l'indépendance le 4 juillet 1946, concernant les relations commerciales (commerce hors taxes entre les deux pays), le maintien de la présence militaire américaine aux Philippines (dont le plus grand bases enclavées en Asie du Sud-Est), ainsi que la "tutelle" américaine dans le domaine de la politique étrangère du pays enfreint la souveraineté des Philippines. Le système de partenariat "relations spéciales" entre l'ancienne métropole et la colonie supposait inévitablement la dépendance des Philippines dans certains domaines vis-à-vis du "partenaire senior", qui se manifestait notamment dans le pro-américanisme unilatéral de la politique étrangère philippine, l'idéologie anti-communiste, et la préservation de la structure coloniale de l'économie dans un premier temps. Mais on ne peut ignorer les bénéfices que retire le « partenaire junior » du système des « relations privilégiées », et surtout dans le domaine de la défense et de la sécurité. Pendant toute la période de la guerre froide à l'échelle internationale et des «guerres chaudes» dans le voisinage en Indochine (1950-milieu des années 1970), les Philippines étaient sous un «bouclier de sécurité» américain fiable. Sans parler des abondantes injections d'aide américaine pour reconstruire l'économie déchirée par la guerre. Mais en ce qui concerne ce dernier, il convient de noter que l'efficacité de ce processus (comme, par exemple, au Japon) a été entravée par le système de liens corrompus forts profondément ancrés dans la société traditionnelle philippine dans le triangle "bureaucratie-politique des affaires" - une sorte de "puits sans fond" qui a absorbé l'essentiel de l'aide et des prêts en provenance des États-Unis, empêchant même une réduction minime de l'écart entre la richesse d'une élite sociale étroite et la pauvreté de la grande majorité de la population. Pourtant, la transition vers une existence indépendante a contribué à des changements sociaux majeurs. Déjà au tournant des années 1940 et 1950, une couche en croissance rapide d'une nouvelle génération d'après-guerre de la bourgeoisie nationale est apparue aux Philippines. Contrairement aux magnats de l'économie d'avant-guerre, qui, en règle générale, appartenaient à l'élite des propriétaires terriens et étaient étroitement liés au marché américain, les nouveaux hommes d'affaires, peu dépendants du capital américain et n'ayant presque pas de racines dans le landlordism, étaient orientés vers marché intérieur, s'intéressaient à l'industrialisation et à la modernisation de l'ensemble du système économique afin de se débarrasser de l'ancienne structure économique coloniale. Enfin, l'aspect socio-politique de la décolonisation. Dans les premières années d'après-guerre, l'attention est attirée sur le niveau extrêmement élevé de politisation et l'extrême fragmentation de la société philippine au sens idéologique et politique, en particulier sur la question du choix de la voie du développement. Dans la scission de la société d'après-guerre, le problème du collaborationnisme était également au premier plan, dans lequel la majorité des Philippins étaient impliqués à un degré ou à un autre. Le débat public sur ce problème ne pouvait pas avoir de réponse sans équivoque (comme dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui ont survécu à l'agression et à l'occupation japonaises). Outre les traîtres purs et simples qui ont participé avec les occupants au pillage des ressources nationales, il y avait une grande couche de Philippins à l'esprit nationaliste (parmi les politiciens, les hommes d'affaires, les intellectuels), qui au début croyaient assez sincèrement à la propagande panasiatique des Japonais. et espérait se débarrasser du colonialisme américain avec l'aide du Japon, en retrouvant une identité asiatique perdue. Le décret présidentiel de 1948 accordant l'amnistie à tous les collaborateurs politiques n'a rien fait pour résoudre ce problème dont les échos ont longtemps troublé l'opinion publique. Les deux pôles les plus importants de l'antagonisme politique et idéologique étaient l'anti-américanisme et le pro-américanisme, paradoxalement étroitement liés l'un à l'autre. Dans les premières années d'après-guerre, le sentiment anti-américain prévalait parmi les Philippins. Mais le pro-américanisme, en tant que phénomène socioculturel qui s'était développé dès la période coloniale, était caractéristique non seulement de l'élite, mais aussi des masses. Cela a donné naissance chez les Philippins à un stéréotype comportemental particulier d'attentes élevées (et, dans une certaine mesure, de dépendance) vis-à-vis de l'interaction avec un "partenaire senior", renforcé par les idées traditionnelles sur les "obligations" des Américains envers leurs anciens pupilles. Ce stéréotype a commencé à prendre forme précisément dans les premières années de l'existence indépendante des Philippines. La politisation des Philippins s'est développée dans le contexte de problèmes sociaux insolubles et de la dévastation économique d'après-guerre qui n'avait pas été surmontée. Si l'on ajoute à tout cela le fait de la libre circulation dans le pays de toutes sortes d'armes (japonaises, américaines), qui a poussé à une solution "facile" de tout problème par la violence, alors il devient évident que le niveau de socio-politique la tension approchait progressivement de l'explosivité. Le détonateur de la plus grande explosion sociale de l'histoire des Philippines d'après-guerre, qui a amené la société au bord d'une guerre civile à grande échelle, a été le Parti communiste philippin (PCF). Aux Philippines, comme dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, la montée du mouvement de gauche et d'ultra-gauche dans les premières années d'après-guerre a été fortement influencée par les attitudes staliniennes qui dominaient le mouvement communiste international, qui orientait les peuples libérés des liens du colonialisme à la lutte armée contre les gouvernements nationaux à peine nés. Aux Philippines, le cadre d'une lutte "révolutionnaire" a abouti à un conflit social prolongé et sanglant de 1948-1953. En 1948, M. Rojas décède subitement. La présidence jusqu'aux prochaines élections de 1949 fut occupée par le vice-président E. Chirino, un politicien incolore mais très ambitieux, un réactionnaire, comme son prédécesseur. Les élections de 1949, remportées par E. Quirino, sont considérées comme les plus sales de l'histoire des Philippines, à en juger par l'ampleur de la corruption et de la violence. Le PCF, utilisant sa popularité d'alors auprès des forces de gauche, comptant sur la situation de crise dans le pays, obéissant inconditionnellement aux directives du mouvement communiste international, s'est engagé sur la voie de l'organisation d'un soulèvement révolutionnaire armé pour prendre le pouvoir. Opérant avec des slogans de lutte des classes avec des appels à l'établissement de la dictature du prolétariat, les communistes n'ont pas tenu compte du petit nombre et du manque de formation de la classe ouvrière urbaine. Historiquement, le radicalisme de gauche aux Philippines avait une base socioculturelle en la personne de la couche la plus nombreuse (80% de la population), la plus défavorisée et la plus arriérée de la société - la paysannerie philippine. Par conséquent, les communistes considéraient les paysans comme une "matière combustible" pour la révolution prolétarienne à venir. Ce n'est pas un hasard si la rébellion a englouti les provinces du centre de Luçon avec les niveaux les plus élevés de propriété et d'absentéisme des propriétaires, des formes archaïques et lourdes de location, et en même temps une profonde érosion des liens verticaux patriarcaux traditionnels entre propriétaires terriens et paysans. Cette dernière, selon le PCF, était censée faciliter l'introduction des idées communistes dans les masses paysannes. Mais même à Luzon, une forte base traditionaliste a été préservée - un système complexe de liens horizontaux traditionnels entre des paysans qui n'étaient pas prêts à accepter la propagande communiste. Par conséquent, le soulèvement de Luzon ne pouvait que prendre la forme d'une guerre paysanne. Dans la conscience de masse des paysans, dans l'idéologie du soulèvement, les idées de la lutte des classes étaient purement abstraites, tandis que la rébellion paysanne typique avec un désir spontané de destruction, des idées et des objectifs maximalistes utopiques prévalaient. Les contacts des rebelles opérant dans les hautes terres de l'intérieur de Luçon avec les dirigeants de Manille du CPP étaient extrêmement faibles. À la tête du soulèvement dans sa phase initiale victorieuse se trouvait Luis Taruk, un leader charismatique populaire parmi la paysannerie. Au début du soulèvement, il était membre de la direction du PCF, puis après un certain temps a quitté le Parti communiste, a été accusé par les communistes de trahison, s'est réellement rendu aux troupes gouvernementales, puis est devenu l'un des organisateurs du légal mouvement paysan et, à la fin, a complètement quitté la politique. Le noyau des forces armées rebelles était constitué de Khuks formés professionnellement, disciplinés et bien armés, qui avaient suivi l'école de la guérilla contre les Japonais dans les rangs des Hukbala-hap. La majorité des détachements insurgés, principalement des métayers et des ouvriers agricoles, étaient mal armés et agissaient par les méthodes de la guérilla paysanne spontanée. 1949 - la première moitié de 1950 est une période de soulèvement. Depuis 1950, Hukbalahap a adopté un nouveau nom - l'Armée de libération du pays (AOS), soulignant ainsi l'orientation de classe de la lutte. Jusqu'à 10 000 combattants ont combattu dans l'AOC, il a été reconstitué aux dépens des paysans pauvres locaux. La panique régnait dans la direction philippine. Après la victoire des communistes en Chine et au Vietnam, on parlait ouvertement à Manille de l'approche de la guerre civile. Les raisons des succès militaires vraiment impressionnants de l'AOC (au début de 1950, l'AOC opérait dans la plupart des provinces de Luzon, essayant de percer jusqu'aux îles Bisai) étaient enracinées dans la faiblesse de l'administration, qui a complètement perdu l'autorité et la confiance des Philippins, la corruption et le manque de professionnalisme des généraux, la démoralisation des officiers et des soldats, dont beaucoup ont ouvertement sympathisé avec les rebelles. Par conséquent, l'assistance militaro-technique régulière des États-Unis, le travail des officiers et conseillers du renseignement américains n'ont pas apporté les résultats escomptés. Afin d'arrêter la dangereuse escalade du conflit armé, il était nécessaire de prendre des mesures urgentes pour relever le moral, la discipline, la préparation au combat de l'armée et procéder à des changements fondamentaux dans la politique publique en général. Ces tâches ont été exécutées par Ramon Magsaysay, membre du Congrès du Parti libéral, qui, au début de 1950, a pris le poste de ministre de la Défense dans le gouvernement d'E. Chirino. Pendant la guerre, Magsaysay commandait une unité de partisans et était professionnellement versé dans les questions militaires. Sa première action en tant que ministre de la Défense a été une purge du personnel au plus haut échelon de l'armée. Il a remplacé les généraux corrompus qui ont été renvoyés par des officiers de rang intermédiaire qui lui étaient personnellement fidèles. Déjà cette action contribuait à l'amélioration de l'atmosphère dans l'armée. Son autorité en tant que chef militaire s'est accrue après une série de victoires contre l'AOC, ce qui lui a permis de passer à l'action pour éliminer les rebelles du centre de Luzon. Dans le même temps, il a habilement et efficacement utilisé l'assistance militaro-technique américaine, dont ses prédécesseurs étaient incapables. Politiquement, ses positions ont été renforcées à la suite de l'arrestation qu'il a organisée à Manille, en fait, dans la composition complète du Politburo du Parti communiste de Finlande et plus d'une centaine de fonctionnaires du parti. Ainsi, les liens déjà minimes entre les rebelles et le centre ont été interrompus. Parallèlement à des méthodes énergiques, Magsaysay a également utilisé d'autres moyens, y compris la propagande, la pratique consistant à infiltrer ses agents dans les rangs des Huks, qui de l'intérieur travaillaient à décomposer l'AOS. Ses principaux atouts sont des promesses de réformes agraires afin d'alléger la situation des métayers et effectivement des mesures d'amnistie et d'octroi de terrains aux rebelles qui déposent les armes. De plus, Magsaysay a repris (après les Américains) un programme de réinstallation de paysans sans terre des zones surpeuplées de Luzon vers le sud peu peuplé avec le droit d'y occuper des terres. Bien qu'un très petit nombre de familles aient été réinstallées, cette mesure a eu un fort effet de démonstration et a contribué à l'abandon de la lutte armée de nombreux paysans. En conséquence, en 1953, le soulèvement a été écrasé. Plus d'une décennie de déclin a suivi dans les mouvements de protestation sociale, et l'anticommunisme dans l'idéologie et la politique s'est intensifié. Selon nous, pour les Américains, Magsaysay était une sorte de « trouvaille heureuse », compensation de l'orientation erronée et coûteuse vers la vieille élite politique philippine qui avait perdu son autorité. Les Américains ont ouvert la voie à Magsaysay, qui n'avait pas de racines dans les clans politiques traditionnels, vers les sommets du pouvoir. Magsaysay a réussi à créer un nouveau type de leader - un charismatique et populiste, mais en même temps un pragmatique et un réformateur, un politicien clairvoyant qui a réalisé la nécessité de changements fondamentaux dans les systèmes économiques et politiques de la société dans l'intérêt de les Philippins. Comme M. Quezon, R. Magsaysay, sans cacher son pro-américanisme et son anticommunisme, attire à lui la plus large partie des Philippins. Son principal soutien est la classe moyenne, la couche croissante d'entrepreneurs nationaux (il les a soutenus et encouragés de toutes les manières possibles) et la paysannerie de plusieurs millions, qui attendait des changements dans la politique agraire. Des promesses de réformes, principalement dans les domaines économique et social, ont constitué la base du programme électoral de R. Magsaysay, qui a présenté sa candidature à la présidence lors des élections de 1953. R. Magsaysay a mené sa campagne électorale sous les slogans populistes du « taoïsme » - l'idée qu'il a formulée de rapprocher les politiciens des Philippins ordinaires - tao, en prêtant attention avant tout à leurs intérêts et à leurs besoins. Aux élections, il a remporté une victoire plus qu'impressionnante sur E. Kirino, qui risquait de briguer un second mandat. Avec sa victoire électorale, les Philippines sont entrées dans la deuxième étape du développement indépendant. R. Magsaysay (1954-1957) ne resta pas à son poste pendant le mandat de quatre ans prévu par la constitution - il mourut en 1957 dans un accident d'avion. Mais au cours des années de sa direction, de nouvelles orientations de politique publique ont été définies, qui se sont reflétées dans les activités des administrations suivantes, car elles étaient liées aux besoins fondamentaux du développement. Encore faible, mais se renforçant rapidement, la nouvelle bourgeoisie nationale a fait de son idéologie du « nationalisme économique » une incitation à briser la structure coloniale de l'économie et un moyen de pression sur le gouvernement en faveur d'une réforme du système économique. Il est significatif que C. Garcia (1957-1961), qui a remplacé R. Magsaysay à la présidence, un conservateur, homme politique d'obédience traditionnelle, ait néanmoins proclamé un cours officiel sous le slogan "Philippins d'abord" ("Pilipino Mupa") - c'était le nom du mouvement nationaliste de la nouvelle bourgeoisie (ses dirigeants et idéologues les plus célèbres et les plus brillants, C. Recto et X. Laurel), visant presque principalement à restreindre les affaires américaines dans le pays et les «empires économiques» d'avant-guerre dépendants à ce sujet (l'introduction du contrôle des importations et des changes et un certain nombre d'autres mesures affectant directement les intérêts du capital américain aux Philippines). Grâce aux lois adoptées par le Congrès philippin, les hommes d'affaires philippins ont pu investir dans l'industrie manufacturière, y compris les industries manufacturières émergentes, sans craindre la concurrence des monopoles américains qui importent des biens de consommation. Ainsi, le début de l'industrialisation aux Philippines a pris la forme d'un modèle de substitution des importations. Il a joué son rôle positif dans le développement de l'économie nationale, contribuant à l'accélération de la croissance économique et à l'élévation du niveau technique de l'économie. Mais à la fin des années 1960, le modèle de substitution des importations s'est épuisé, démontrant son incapacité à contribuer à l'expansion du marché intérieur à long terme, principalement en raison de la faible solvabilité de la majorité de la population. Sur le marché extérieur, cependant, il n'était pas compétitif, passant d'un accélérateur de la croissance économique à un facteur de son confinement. Dans le même temps, les Philippines étaient à la traîne des pays voisins les plus avancés d'Asie du Sud-Est en termes de taux de croissance, où des modèles d'économie orientée vers l'exportation ont été établis sous un régime autoritaire. De plus, aux Philippines, le plus arriéré, non réformable, reste le secteur agricole. Toutes les tentatives des autorités (en particulier les présidents Magsaysay et Macapagal, 1961-1965) pour faire passer au Congrès une loi de réforme agraire visant à capitaliser l'économie rurale sont bloquées par une puissante élite foncière, dont les représentants l'emportent au parlement. La possession de grandes propriétés foncières (depuis l'époque espagnole, et surtout sous les Américains) a donné aux propriétaires fonciers un pouvoir local presque illimité et a ouvert la voie à la grande politique. Les spécificités du colonialisme américain ont également été affectées. La ville a fait l'objet d'une « expérience démocratique ». Ici, nous devrions vraiment parler de l'introduction de valeurs démocratiques, d'institutions, d'un ordre juridique, de changements sérieux dans le renforcement de l'économie de marché, de la formation de la classe moyenne et d'éléments de la société civile. Mais toutes ces innovations n'affectent pas la périphérie agraire. Les Américains ont délibérément adhéré au dualisme dans la politique coloniale, encourageant la propriété foncière (un bastion du traditionalisme et du conservatisme dans la société philippine), en veillant au soutien social du régime et à la stabilité de l'État colonial. L'élite terrienne, déjà sous les Américains, usant de sa puissance économique, a commencé à s'emparer des partis, du système électoral et des autres structures de la « démocratie coloniale » qui était en train de s'implanter. À l'époque postcoloniale, lorsque les Philippines ont perdu la tutelle politique directe des États-Unis, l'écart entre la démocratie externe du système politique et son contenu interne est devenu de plus en plus évident. Pour la première fois, cette divergence a été étudiée en profondeur dès le début des années 1960 dans les travaux classiques du politologue américain K. Lande. Le modèle libéral-démocratique qui s'est imposé aux Philippines était une sorte de démocratie dite oligarchique, lorsque le pouvoir réel dans l'État, tout en conservant formellement les attributs d'un système représentatif, était concentré entre les mains d'un gouvernement étroit et socialement fermé. élite - la "vieille oligarchie". Dans le même temps, aux Philippines, comme dans aucun autre pays d'Asie du Sud-Est, l'élite dirigeante était extrêmement divisée selon des lignes claniques et régionales : les conflits interclaniques ressemblaient à des conflits civils féodaux. Les caractéristiques «génétiques» de l'élite dirigeante philippine: clanisme, factionnalisme, isolement social, opportunisme, incapacité à avoir un leadership démocratique fort - ont déterminé la faible efficacité du pouvoir politique, contribuant au chaos du processus politique. En particulier, cela s'est clairement manifesté dans les actions du système parlementaire de partis, qui avait des caractéristiques extérieures de démocratie, mais servait en fait d'instrument de redistribution du pouvoir entre des clans politiques rivaux. Les deux partis qui se sont succédé au pouvoir, le PN et le LP, n'ont pas permis la formation d'un « tiers » capable de leur faire concurrence. Partis de type traditionnel (associations fondées sur le principe "leader-followers"), le PN et le LP agissaient avec des programmes quasiment identiques, ne différant l'un de l'autre que par le soutien prédominant de l'électorat de "leurs" régions. Le PN a traditionnellement dominé dans les régions tagalog du sud de Luzon et sur l'île de Cebu, le LP - dans les provinces du nord de Luzon (Ilocos, etc.). L'amorphisme des formations partisanes, l'absence de discipline de parti ont donné lieu à la pratique de transitions libres d'un parti à l'autre, principalement des candidats aux plus hautes fonctions électives, si le changement de parti leur était tactiquement bénéfique, du point de vue de élargir l'électorat en votant pour eux. En conséquence, ils "emmenèrent" la plupart de leurs partisans avec eux dans le "nouveau" parti. Par exemple, le passage au moment de l'élection des présidents Magsaysay et Marcos du PL au PN (en 1953 et 1965). L'élite dirigeante a réalisé ses ambitions de pouvoir principalement à travers le congrès, qui s'est transformé en arène de lutte interclanique, source de corruption, lobbying des élites locales auprès de « leurs » députés. Les tentatives de rationaliser le processus politique, de réduire l'intensité de la lutte entre les factions sont venues des présidents qui dirigeaient l'exécutif. Mais comme les présidents avaient tendance à appartenir aux mêmes dynasties politiques et clans, ils perdaient généralement contre les législateurs (un exemple classique est le blocage des projets de loi de réforme agraire par les oligarques). Au milieu des années 1960, l'insoutenabilité du système politique était reconnue dans diverses sections de la société philippine. L'incertitude de l'économie, causée par l'abandon de la politique de substitution des importations et la recherche d'un nouveau modèle de développement efficace, s'est ajoutée à la crise politique qui couvait. Dans le domaine social, la répartition inégale des revenus s'est accrue et l'écart entre les pôles de richesse et de pauvreté s'est creusé. La concentration du pouvoir entre les mains de l'élite oligarchique, avec la faiblesse de l'État, incapable de protéger les intérêts de larges couches de la société, a inévitablement conduit à des flambées de sentiments d'opposition, à l'émergence de mouvements de protestation sociale. Dans les villes, principalement dans la métropole métropolitaine, dans le spectre hétéroclite des forces d'opposition, le flanc gauche s'est renforcé - le mouvement nationaliste radical et le Parti communiste légalisé, dans lequel des éléments extrémistes, adeptes des idées maoïstes, ont commencé à jouer un rôle actif. L'opposition libérale était représentée par des groupes et des organisations dispersés et faibles, dont le plus influent était le Mouvement social chrétien, dirigé par R. Manglapus, qui a créé une certaine version philippine de la théorie du socialisme chrétien. Avec la propagation des tendances déstabilisatrices parmi les Philippins, des partisans actifs d'un leadership fort et d'un pouvoir d'État fort, capables de rétablir l'ordre et de consolider la société, ont commencé à apparaître. L'un des auteurs de l'Histoire de l'Asie du Sud-Est de Cambridge définit la réorganisation du système de pouvoir dans le sens étatique comme un "gouvernement maximal". L'expression la plus holistique des idées de la persuasion autoritaire-étatiste a été reçue dans les vues de deux personnalités politiques majeures représentant l'establishment politique, les sénateurs F. Marcos et B. Aquino, rivaux dans la lutte pour la présidence, puis ennemis irréconciliables. L'essentiel de leurs programmes : la centralisation du pouvoir entre les mains du président comme seul moyen d'intégrer la société et de mobiliser les masses ; la priorité des transformations de modernisation de l'économie, en premier lieu - l'élimination de la propriété foncière et la mise en œuvre de la réforme agraire. Leur rivalité personnelle s'est terminée par la victoire du pragmatique et volontaire F. Marcos, qui avait déjà acquis une énorme popularité parmi les Philippins au milieu des années 1960. B. Aquino, avec son penchant pour la rhétorique trop émotionnelle et, surtout, le rapprochement en quête de soutien avec certains groupes de gauche et d'ultra-gauche, s'est aliéné de nombreux partisans potentiels. F. Marcos, au contraire, a gagné en désignant l'ensemble du mouvement de gauche comme "communiste" et en pointant dans des discours publics la réalité de la "menace communiste". Deux réalisations importantes peuvent être distinguées dans les activités de la première administration de F. Marcos. Dans le domaine économique, c'est le début d'une transition vers un modèle orienté vers l'exportation qui a démontré des résultats impressionnants dans le développement des économies des pays voisins d'Asie du Sud-Est. Dans le domaine de la politique étrangère - rejoindre l'organisation régionale ASEAN (1967), qui a marqué le début du renforcement de la direction asiatique dans la politique étrangère de l'État. Mais il n'a pas été possible d'arrêter les processus de déstabilisation de la première administration de F. Marcos. De plus, à la fin des années 1960, les caractéristiques d'une crise structurelle étaient de plus en plus évidentes aux Philippines. L'une de ses principales composantes a été la forte activation des forces d'extrême gauche. En 1968, un groupe ultra-radical s'est séparé du CPP, formant le Parti communiste des idées de Mao Zedong (aujourd'hui simplement connu sous le nom de CPP), dirigé par H.M. Saison. Dans le même temps, son détachement de combat, la Nouvelle Armée populaire (NNA), se forme, principalement à partir de paysans, d'étudiants, des restes des Khuks cachés dans les montagnes, qui mènent une lutte armée dans les régions profondes de l'archipel. Une situation grave s'est développée dans les régions du sud, peuplées de musulmans (comprenant 5 à 7 % de la population totale) du pays, où un mouvement séparatiste armé est apparu à la fin des années 1960. Ses dirigeants étaient des jeunes de l'élite locale scolarisés dans des centres religieux islamiques étrangers (Arabie Saoudite, Libye, etc.). L'un d'eux, Nur Misuari, a fondé en 1968 la première grande organisation, le Front de libération nationale Moro (MFNL), avec un programme visant à séparer le sud musulman de l'État unitaire et à former une république islamique indépendante (Bangsa Moyu) dans les îles du sud. . L'extrémisme musulman aux Philippines a de profondes racines historiques63. Les flambées spontanées de violence, les affrontements sanglants entre les groupes armés moro et les chrétiens locaux n'ont pas réellement cessé pendant la période de décolonisation et de formation de l'État national. Mais depuis la fin des années 1960, le mouvement musulman est entré dans une phase organisationnelle et idéologique qualitativement nouvelle. Le caractère séparatiste du mouvement a été largement provoqué par la politique d'unitarisme étatique stricte poursuivie par les autorités, la discrimination politique et socio-économique de la minorité musulmane non surmontée, le retard économique de la périphérie musulmane par rapport au centre chrétien, et le problème particulièrement douloureux de la réinstallation des chrétiens dans les îles du sud, où ils occupaient des terres que les musulmans considéraient avant tout comme les leurs. De plus, les deux principales communautés confessionnelles se caractérisent par une complète aliénation culturelle. Les Philippins musulmans, orientés vers les valeurs de l'islam, n'avaient pas (et n'ont pas) le sentiment d'appartenir à une seule communauté philippine. Le facteur purement civilisationnel ne peut en aucun cas être ignoré. Néanmoins, malgré l'aggravation de la situation de crise, la plupart des Philippins n'ont pas perdu confiance en F. Marcos, le considérant comme le leader fort capable d'améliorer la situation dans le pays. Lors de l'élection présidentielle de 1969, F. Marcos l'emporte à nouveau (il s'agit du seul président de l'histoire des Philippines postcoloniales à être élu pour un second mandat). C'est au cours de la seconde présidence que F. Marcos fit les premiers vrais pas vers la réalisation de son projet grandiose de restructuration du système politique et économique. A la veille des élections de 1969, il formule un certain nombre de dispositions sur une « nouvelle idéologie politique » pour les Philippines, remettant sans ambiguïté en cause les perspectives des principes démocratiques libéraux d'organisation de la société philippine. Selon lui, elles engendrent le chaos politique, la corruption et, finalement, paralysent le fonctionnement de l'appareil étatique. La campagne électorale s'est déroulée sous les slogans populistes « du riz et des routes » et contenait de vives critiques de l'injustice sociale. L'idée s'est exprimée de la nécessité d'une « révolution par le haut », à l'initiative du gouvernement, pour combattre « la pauvreté et l'injustice sociale » afin d'éviter une révolution violente (« jacobine ») par le bas à la suite d'une crise sociale. explosion. Le passage à un État autoritaire dans les conditions d'une situation de crise aiguë de l'économie, alors que le modèle de «démocratie oligarchique» s'autodétruisait et que la montée massive d'une opposition hétéroclite, y compris extrémiste, était, évidemment, la seule véritable issue de la crise et l'orientation de la société vers une modernisation capitaliste accélérée. Environ un an avant la fin de son deuxième mandat présidentiel, F. Marcos a introduit en septembre 1972 la loi martiale dans le pays, ce qui devrait être considéré Apparemment , le point de départ d'une décennie et demie d'autoritarisme aux Philippines. Introduisant la loi martiale et se référant à la constitution actuelle de 1935, F. Marcos a distribué les «menaces» ona à la colonie espagnole sous le slogan religieux «guerre de la croix et du croissant» comme suit. Les Moros étaient considérés comme des « infidèles » non seulement par les colonisateurs, mais aussi par les habitants des provinces du centre et du nord de la colonie convertis au catholicisme. sécurité et stabilité : « danger communiste » - l'ampleur croissante de la lutte armée du NPA, dirigée par le Parti communiste des idées de Mao ; la menace « de droite » des clans oligarchiques tout-puissants est le facteur de déstabilisation le plus important qui pousse la société au bord de la guerre civile ; les opérations militaires des séparatistes musulmans dans le sud du pays sous la direction de la FNOM sont une menace pour la structure unitaire et l'intégrité territoriale de l'État. F. Marcos s'est appuyé sur de nouveaux hommes d'affaires, des technocrates et l'armée (avec l'introduction de la loi martiale, en fait, sa politisation a commencé), mais la majorité des Philippins ordinaires ont soutenu le président avec enthousiasme. Les premières mesures de F. Marcos ont été la dissolution du parlement, qui était complètement en faillite aux yeux de la population, l'interdiction des partis, ainsi qu'une action d'une extrême importance - la liquidation d'armées privées d'oligarques avec la confiscation de environ 500 000 armes qui étaient entre des mains privées. Ces premières actions ont été suivies de répressions contre un certain nombre de représentants de l'élite politique, des oligarques, des fonctionnaires arrêtés sous l'inculpation d'activités subversives. L'une des premières victimes a été B. Aquino, qui, en prison, a révisé ses vues antérieures et s'est progressivement installé dans la position du chef le plus important de l'opposition anti-autoritaire anti-Marcos. En réponse aux répressions, un flot d'émigrants de différentes couches de la société a surgi, mécontents des changements survenus dans leur patrie, se dirigeant principalement vers les États-Unis, où des centres d'opposition anti-Marcos ont surgi et des contacts ont été établis avec les membres du Congrès américains qui perçu la politique de F. Marcos. Selon des auteurs occidentaux, l'émigration philippine vers les États-Unis pendant toute la période du régime autoritaire aux Philippines a atteint près de 300 000 personnes. F. Marcos a proclamé la construction d'une « nouvelle société » comme l'objectif national principal par opposition à la « vieille société », qui, ayant perdu la capacité de vivre, est vouée à quitter la scène historique. Au moment où la loi martiale a été introduite, F. Marcos avait déjà développé le concept de «nouvelle société», qui, si nous en parlons brièvement, contenait des éléments des doctrines économiques modernes, la théorie de la «révolution par le haut» (alias « révolution du centre »), ainsi que des idées nationalistes et populistes. F. Marcos a également eu recours au concept de "révolution démocratique", qui a été en fait élevé au rang d'idéologie officielle de l'État. Son essence est le désir de présenter le processus de transformation capitaliste comme la renaissance de « véritables traditions nationales » (« démocratie barangay »64), les formes originelles philippines d'organisation sociale. Toutes ces idées ont été présentées par F. Marcos dans de nombreux ouvrages et discours publics. Il a largement repris (et emprunté) l'expérience des pays partenaires de l'ASEAN (Malaisie, Singapour, Indonésie). Immédiatement après l'introduction de la loi martiale aux Philippines, la mise en œuvre de la nouvelle politique économique, élaborée par un groupe de technocrates et d'économistes dirigé par le président, a commencé. Le changement de cap de l'économie supposait une augmentation notable du rôle de l'État dans la gestion de l'économie, la création de 11 complexes industriels pour le passage au stade de la "modernisation sélective". Le modèle d'orientation vers l'exportation a été choisi pour restructurer la structure de l'industrie et la nomenclature des exportations et des importations. Le nouveau concept de développement tourné vers l'extérieur a changé les anciennes règles de la croissance et déterminé les perspectives de développement ultérieur de l'économie (au début des années 1970, la croissance économique atteignait 6,2 % contre presque zéro au plus fort de la crise au tournant de les années 1970). Tous ces changements au début des années 1970 ont donné l'impression que les Philippines étaient entrées dans le courant dominant du développement dynamique, à l'instar d'autres États d'Asie du Sud-Est - partenaires philippins de l'ASEAN, qui à cette époque avaient déjà obtenu des résultats significatifs en matière de modernisation économique. Ce n'est pas pour rien qu'à cette époque F. Marcos était comparé à rien de moins que Lee Kuan Yew, le dirigeant de Singapour, l'État le plus prospère de la région. Mais il est vite devenu clair que la "formule de réussite" des pays de l'ASEAN - pouvoir d'État fort, croissance économique, ordre social, discipline - ne fonctionnait pas aux Philippines. Une tradition démocratique et constitutionnelle assez profonde dans la culture politique philippine a empêché la pleine mise en œuvre des tendances étatistes et la solide consolidation d'un État autoritaire. L'État autoritaire dans les conditions philippines n'a pas acquis la fonction de stimulateur et de garant de la modernisation économique. Au contraire, à mesure que le système de gouvernement autoritaire et bureaucratique s'est établi, le rôle inhibiteur de l'État dans le domaine de l'économie s'est intensifié. Déjà au milieu des années 1970, une récession économique a commencé, qui s'est transformée en stagnation puis en crise aiguë au tournant des années 1980. Tout cela était lié, en particulier, au fait que F. Marcos n'a réussi à faire sortir que positions politiques "vieille oligarchie", mais n'a pas pu briser son pouvoir économique - les anciens magnats ne sont entrés que temporairement dans l'ombre, sabotant progressivement les initiatives de réforme de l'administration. Une stabilité rare du comportement traditionnel de l'élite dirigeante philippine a également été révélée. La nouvelle élite des nouveaux riches et l'entourage de F. Marcos ont complètement répété les stéréotypes comportementaux de l'ancienne élite oligarchique : factionnalisme, myopie politique, préférence pour les intérêts et objectifs de groupe et personnels, liens corrompus entre la bureaucratie, les affaires et les politiciens. Tout cela a entravé la poursuite de la politique de réforme. C'est à la fin des années 1970 qu'est apparu le terme « capitalisme de la couronne » (ou kronism, de l'anglais, copinage - un ami proche), c'est-à-dire amis et favoris du président et de sa femme - I. Marcos, qui ont détourné des fonds publics et se sont embourbés dans la corruption. Les pragmatistes-technocrates, initiateurs de la modernisation économique forcée, ont perdu leur poids politique, laissant la place aux positions de la « vieille » bureaucratie. L'armée devient de plus en plus l'épine dorsale du pouvoir présidentiel, et les plus hauts postes de commandement sont occupés par des gens de la province d'Ilocos, la « petite patrie » de F. Marcos (le terme « iloconisation de l'armée » est souvent utilisé dans la littérature). ), dirigé par le chef d'état-major général, le général F. Ver. Ils ont été opposés par les soi-disant Westpointers, qui ont reçu une éducation militaire supérieure aux États-Unis. Il y avait une inimitié persistante entre F. Ver et son adjoint "West Pointer" le général F. Ramos (futur président des Philippines). La politisation de l'armée est allée assez loin - des postes les plus bas aux postes les plus élevés, les militaires n'assumaient en aucun cas des fonctions non militaires (dans les affaires, l'administration, etc.). Ici, F. Marcos essayait clairement d'utiliser l'expérience indonésienne, bien que cela, bien sûr, soit incomparable avec les réalités du régime bureaucratique militaire alors rigide en Indonésie. F. Marcos a défini le régime du pouvoir personnel aux Philippines comme « l'autoritarisme constitutionnel ». Le régime autoritaire philippin était une variété détendue et «libérale» d'autoritarisme. Aux Philippines, initialement semi-légales, et depuis le milieu des années 1970, l'activité tout à fait légale de l'opposition anti-autoritaire démocratique de la persuasion centriste était autorisée (l'État n'était tout simplement pas en mesure de faire face à l'énorme échelle de l'extrémisme de gauche illégal ). Face à l'apparition de phénomènes de crise dans l'économie (fin des années 1970) et de désillusion face au cours des réformes en cours, F. Marcos est contraint de libéraliser le régime. En janvier 1981 La loi martiale a été abolie, sur laquelle insistaient à la fois l'opposition et une partie de l'élite dirigeante, préoccupée par le renforcement de la «dynastie Marcos» et à l'avenir par l'éventuel transfert du pouvoir entre les mains d'Imelda Marcos (la présidente de l'époque était souffrant déjà d'une maladie rénale grave)65. Avec la levée de la loi martiale sous une forme réduite, les libertés démocratiques ont été restaurées. Les prochaines étapes de la "libéralisation progressive" ont été l'autorisation des activités des partis, des organisations publiques et des élections parlementaires (mai 1984). Mais toutes ces mesures étaient de nature décorative. Ils ont été précédés de référendums nationaux, organisés sous le contrôle du gouvernement, laissant à Marcos le plein pouvoir et l'unité de commandement dans la prise de décisions politiques. La libéralisation de façade n'a pas sauvé le régime, mais a seulement rapproché son effondrement. F. Marcos n'a pas pu surmonter le clivage entre traditionalisme et innovation. Ne parvenant pas à réaliser ses plans vraiment vastes de modernisation des réformes, il revient progressivement à l'image et au comportement habituels d'un homme politique traditionnel (trapo), occupé à l'enrichissement personnel et à nourrir une élite corrompue et gonflée sous son patronage ("nouvelle oligarchie"). En conséquence, la popularité massive de F. Marcos a été remplacée par le mécontentement de la majorité des Philippins face à son seul pouvoir. Le rôle de catalyseur dans l'agonie du régime a été joué par l'assassinat du chef de l'opposition démocratique et de l'adversaire le plus dangereux de F. Marcos - B. Aquino. Sorti de prison, il part en 1980 pour les États-Unis (pour se faire soigner), où il s'emploie à consolider l'opposition émigrée anti-Marcos. À l'été 1983, il décide de retourner dans son pays natal pour participer aux élections législatives de 1984 et est abattu à l'aéroport de Manille, à peine descendu de l'avion. Les Philippins ont immédiatement associé cet assassinat politique très médiatisé au nom de F. Marcos. Cet événement tragique a eu des conséquences littéralement dans toutes les sphères de la société. Dans l'économie - le transfert (à une échelle sans précédent) de capitaux à l'étranger, la dépréciation du peso de 6 à 20 pour 1 dollar. millions de personnes). En politique, une forte augmentation des discours anti-Marcos spontanés (plusieurs milliers de manifestations, marches de protestation, etc.) avec la participation de presque toutes les couches de la population, y compris les radicaux de gauche, sous le slogan "A bas les États-Unis- dictature de Marcos » (ils accusaient ce dernier d'entretenir des liens étroits avec le président américain de l'époque, R. Reagan). Seule la désunion des forces d'opposition a sauvé ce que F. Marcos Mouvement pour une nouvelle société de la défaite aux élections législatives de mai 1984, après quoi un nouveau cycle de montée du mouvement d'opposition a immédiatement commencé, qui s'est poursuivi en 1985. Dans cette situation, F. Marcos a annoncé des élections présidentielles anticipées en février 1986 . , espérant avec leur aide affaiblir l'opposition, sans lui laisser suffisamment de temps pour préparer la campagne électorale. Mais il a fait une grave erreur en sous-estimant la profondeur crise politique . L'annonce soudaine de la date des élections (fin 1985) a au contraire contraint l'opposition à passer à la consolidation de ses rangs. Il est devenu évident que la nomination de plus d'un candidat de l'opposition assurait automatiquement la victoire de F. Marcos. Après des discussions acharnées, l'opposition a nommé un seul candidat à la présidence - la veuve de B. Aquino Corazon Aquino. Le rôle décisif dans la nomination de ce candidat particulier a été joué par le chef de la hiérarchie catholique aux Philippines, le cardinal X. Sin (dans un pays où plus de 80% sont catholiques, l'initiative de X. Sin ne pouvait que rencontrer un soutien de masse) . Quant aux États-Unis, il n'y avait pas d'unité dans l'élite politique américaine concernant les événements aux Philippines. R. Reagan et l'administration dans son ensemble ont presque jusqu'au bout soutenu F. Marcos, et un puissant lobby anti-Markos était actif à la chambre basse du Congrès américain. Le Département d'État, les services secrets et certains membres du Congrès, suivant attentivement les développements aux Philippines, après les élections du 7 février 1986, ont commencé à soutenir ouvertement K. Aquino et ses partisans. Les élections de février, quant à elles, n'ont pas clarifié la situation : tant F. Marcos que C. Aquino se sont déclarés vainqueurs, s'accusant mutuellement d'avoir falsifié la procédure électorale. L'issue de la lutte politique n'a été décidée qu'après la transition du 22 février 1986 aux côtés de C. Aquino, ministre de la Défense X. Enrile et du général F. Ramos, qui avec leurs troupes ont occupé les camps de la capitale - Aguinaldo et Krame. Une tentative de F. Marcos de jeter contre les généraux rebelles les troupes qui lui étaient fidèles fut contrecarrée par l'intervention de l'église. Tout au long des nombreux kilomètres de l'autoroute Epifanio de los Santos, remplie de milliers de manifestants (d'où l'un des noms des événements du 22 au 25 février - « révolution EDSA », de l'abréviation du nom de la rue), reliant le centre de Manille à la périphérie, où se trouvent des camps militaires, les ministres de l'église sont allés à la rencontre des soldats, les protégeant de l'effusion de sang. Le 25 février 1986, K. Aquino a été proclamé septième président des Philippines à Camp Crum. Une cérémonie similaire a eu lieu à Malacañan, où F. Marcos a été déclaré président. Mais cette action n'avait plus de sens. L'administration de R. Reagan a reconnu la victoire de K. Aquino, sur ses instructions, F. Marcos et sa famille ont été emmenés à Hawaï. Les événements du 22 au 25 février 1986 sont entrés dans l'histoire des Philippines sous le nom de révolution "People Power" (du nom de la coalition de partis créée par C. Aquino). Elle était non violente, exsangue. Contrairement à la « nouvelle société » de Markos, les années de K. Les Aquinos ont été appelés la "nouvelle démocratie", symbolisant la transition vers la redémocratisation. Son véritable aboutissement positif est la formalisation constitutionnelle et juridique du nouveau régime. En février 1987, une nouvelle constitution-87 a été ratifiée lors d'un référendum national, basée sur le concept démocratique des droits de l'homme, des libertés civiles, de leur protection par la loi, de l'État de droit, de la légitimité du pouvoir politique, etc. Les Philippines ont conservé une forme de gouvernement présidentiel, le mandat étant prolongé de quatre à six ans. Dans le même temps, une série d'articles a été insérée dans le texte de la Loi fondamentale pour limiter le pouvoir du président, le privant principalement du droit d'être réélu pour un second mandat (afin que le "précédent Marcos" ne pas être répété). Pour le reste, le gouvernement de C. Aquino s'est avéré impuissant à surmonter le difficile héritage du régime Markos (une crise économique prolongée et une tension sociale incessante) et à mettre en œuvre ses propres programmes pour stabiliser et améliorer la situation. Dans le domaine économique, le gouvernement de C. Aquino, avec l'aide d'une équipe de technocrates, a tenté de mettre en œuvre une série de réformes pour passer à une politique économique libérale, réduire le rôle de l'État dans l'économie et développer le marché. (programme 1987-1992). Des tentatives ont été faites pour relancer et mener à bien une réforme agraire "sélective", mais les allocations pour celle-ci ont cessé à la fin de 1987. Au début des années 1990, la crise du secteur des combustibles et de l'énergie a commencé à se propager à d'autres secteurs de l'économie. L'échec des projets économiques s'explique non seulement par le manque d'expérience et le manque de volonté politique de la part du président et du gouvernement, mais dans une large mesure par la nature même de la redémocratisation, qui a renvoyé les valeurs traditionnelles et les stéréotypes de comportements inadaptés aux besoins du développement social moderne. En fait, une version aggravée du système politique qui avait fonctionné jusqu'en 1972 s'est formée aux Philippines (conflits inter-factionnels et interpersonnels) ; le retour à une activité vigoureuse des clans politiques traditionnels (les Laurel, les Lopez, la famille Kohuangko de métis chinois, dont est issu C. Aquino), étroitement associés aux « anciens » monopoles économiques, dont F. Marcos. Le manque d'unité était caractéristique de toutes les composantes du système politique (à commencer par les institutions les plus importantes - l'armée et l'église), au sein desquelles se battaient partisans et opposants au nouveau régime. A cela s'ajoute l'absence de formation d'un système multipartite composé de coalitions et de blocs fragiles. L'ensemble a accru la nature chaotique du processus politique. L'administration a également été vaincue dans une tentative de freiner le "mal éternel" - la corruption et les pots-de-vin. Enfin, pendant toute la première phase post-autoritaire, l'opposition extrémiste de diverses obédiences a été active : les rebelles de gauche dirigés par la NNA dans les zones chrétiennes (dans la seconde moitié des années 1980, leur nombre a atteint 30 000 personnes), les séparatistes musulmans ont continué leur lutte armée dans le sud du pays ; un nouveau phénomène est apparu - une opposition armée à l'échelon intermédiaire de l'armée (Mouvement pour la réforme de l'armée), qui a fait sept tentatives de coups d'État pour chasser K. Aquino du pouvoir, accusé par les putschistes d'être incapable gouverner l'État. K. Aquino a réussi à réprimer les rébellions, en s'appuyant sur les généraux fidèles dirigés par F. Ramos et sur le soutien moral des États-Unis. Le pro-américanisme des élites dirigeantes, en particulier C. Aquino, a été une source de mécontentement public, les radicaux de gauche ont même changé la formule précédente "dictature US-Marcos" en "dictature US-Aquino". En réalité, cependant, au début des années 1990, la « relation spéciale » avait radicalement changé. Avec la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis ont considérablement réduit leur intérêt et leur niveau de présence en Asie du Sud-Est. Par conséquent, la décision du Sénat philippin (1991), dominé par les nationalistes, d'éliminer les bases de l'enclave américaine aux Philippines a été accueillie assez calmement par les Américains (en 1992, les plus grandes bases ont été retirées du territoire de l'archipel - l'air base à Clark Field et la marine à Subic Bay). Les événements de 1986 ont donné naissance au terme de "phénomène Aquino", la première femme présidente de l'histoire du pays. Dans la conscience de masse des Philippins (en grande partie grâce aux efforts de l'Église), une certaine image idéalisée d'un martyr, victime de la dictature, porteur de la mission messianique de « sauver la nation et la démocratie » (dans l'esprit de le catholicisme et les traditions de la socio-culture locale) a pris racine. De plus, étant l'épouse de l'un des dirigeants les plus brillants et les plus actifs, elle ne pouvait s'empêcher de rejoindre l'art de la "grande politique". Elle a habilement utilisé son charisme personnel, fait appel à la rhétorique populiste et, au début, nationaliste de gauche, a maintenu l'image d'un Philippin idéal - un catholique vertueux, modeste, zélé, gardien du foyer familial. Les échecs de la politique économique, l'inutilité des tentatives de trêve avec les rebelles de gauche et les séparatistes musulmans, l'implication de ses proches dans la corruption ont entraîné une baisse notable de la cote du président. Néanmoins, C. Aquino a mené avec succès son propre jeu politique, conservant le pouvoir dans les délais impartis par la constitution. A l'aide de manœuvres, elle réussit à maintenir un rapport de force : le président - le sommet de l'armée - l'église, ce qui freina la déstabilisation politique, l'empêchant de se transformer en crise de pouvoir. En tout cas, elle réussit à assurer une alternance démocratique du pouvoir à la suite des élections présidentielles tenues conformément à la constitution en mai 1992. Le problème de la stabilisation était un problème clé dans la deuxième étape post-autoritaire. Son jalon chronologique est l'accession à la présidence le 30 juin 1992 du huitième président des Philippines, F. Ramos, qui a remporté les élections de mai (K. Aquino a soutenu sa candidature). F. Ramos est un intellectuel et un pragmatique qui a violé les normes habituelles des politiciens philippins d'un rang aussi élevé. De par son origine, il n'était pas associé aux clans politiques traditionnels, pour la première fois dans l'histoire des Philippines, un militaire professionnel, un général qui faisait partie de la haute direction des forces armées sous F. Marcos et C. Aquino, s'est avéré être le chef de l'État. C'est aussi le premier président protestant dans un pays catholique. En tant que type de leader, F. Ramos a poursuivi une petite liste de "présidents forts" - M. Quezon, R. Magsaysay, F. Marcos. Avec son arrivée au pouvoir, le pendule de la politique philippine a basculé dans le sens de la centralisation et du renforcement du pouvoir de l'État. La devise de sa campagne électorale est une démocratie de travail avec un gouvernement démocratique fort capable de consolider la société. Ce n'était pas une rhétorique de propagande ordinaire. Sous F. Ramos, de nouvelles tendances de développement ont émergé - vers le renforcement du pouvoir du président, la réforme et la modernisation accélérée de l'économie comme base de stabilisation, mais contrairement à l'expérience essentiellement similaire de F. Marcos, sans déformer les institutions démocratiques et le État de droit, sans porter atteinte aux droits civils. Dans le programme des "trois modernisations" (1994) - économique, sociale, politique - la première place était prise par l'économie. Pour 1992-1996 Les Philippines sont passées d'années de ruine économique à la stabilité économique. La dynamique de la croissance économique est passée de zéro indicateur au tournant des années 1990 à 6,5% de croissance du PIB et 7,3% du PNB en 1996. La modernisation de l'économie s'est appuyée sur le programme de libéralisation de la politique économique approuvé par le FMI, qui comprenait toute une série de mesures : dénationalisation, privatisation, encouragement à l'entreprise privée, création de zones économiques spéciales, création d'un climat favorable aux investissements étrangers, élargissement de la participation des Philippines à la division internationale du travail. A la fin des années 1990, les Philippines pourraient vraiment devenir l'un des nouveaux pays industrialisés. Comme vous le savez, la crise asiatique de 1997-1998, qui a frappé tous les pays d'Asie du Sud-Est, a eu un impact négatif sur la situation économique des Philippines. Mais la politique économique compétente de F. Ramos (associée à un certain nombre de circonstances objectives) a permis d'amortir quelque peu les conséquences de la crise par rapport à la situation des autres pays de l'ASEAN. La base sociale du gouvernement de F. Ramos était composée de technocrates, représentants d'une partie importante des milieux d'affaires et financiers, de la classe moyenne, en d'autres termes, de tous les éléments de la société qui ont été impliqués dans le processus de modernisation et ont bénéficié de la relance de l'économie de marché. Au cours de la stabilisation politique, des changements positifs ont eu lieu pour contenir l'opposition extrémiste : les opposants militaires ont été partiellement neutralisés, partiellement attirés du côté du gouvernement ; l'ampleur du mouvement rebelle de gauche a été réduite, notamment en raison de la légalisation du PCF et d'une large amnistie pour les participants à la lutte armée. La troisième composante de l'opposition extrémiste - le séparatisme musulman - a également été affaiblie dans une certaine mesure. En septembre 1996, sans exagération, un événement historique a eu lieu - la signature (à la suite de négociations complexes en plusieurs étapes avec les séparatistes) à Manille, par la médiation de l'Indonésie, d'un traité de paix entre l'administration de F. Ramos et la plus grande organisation séparatiste, la FNOM. Pour la première fois, un programme tout à fait réaliste de développement du Sud est adopté et une autonomie est créée (dans un certain nombre de provinces des îles de Mindanao et Sudu), dirigée par un leader musulman, Nur Misuari. Bien sûr, la réconciliation n'était pas complète et durable - il y avait encore un certain nombre d'organisations et de groupes séparatistes qui continuaient la lutte armée. Le plus difficile a été le processus de réforme du système politique, où opèrent des stéréotypes stables de la culture politique traditionnelle. Cependant, là aussi, à l'aide de manœuvres complexes, F. Ramos a réussi à rallier une partie des partis d'opposition à ses côtés. Les premiers pas vers la consolidation de l'élite politique autour du programme de réforme du président ont porté leurs fruits lors des élections législatives de mi-mandat de mai 1995, où une coalition pro-gouvernementale de trois blocs de partis a remporté une victoire retentissante. Les dernières années de la présidence de F. Ramos (à partir de fin 1996 environ) ont été assombries par le déclenchement d'une lutte politique acharnée liée au problème d'un changement de pouvoir. Les partisans de F. Ramos, intéressés à poursuivre le cours des réformes, ont créé un large mouvement public pour sa réélection pour un second mandat. Les 5 millions de signatures nécessaires ont été recueillies sur une pétition au Congrès, qui était censé autoriser un plébiscite sur l'adoption d'un amendement approprié à la constitution. Cette initiative a été accueillie négativement dans les deux chambres du Congrès. Mais même de nombreux Philippins ordinaires craignaient un retour à la dictature (d'autant plus que la présidence devait à nouveau revenir au général et ancien allié de F. Marcos). En 1997, une vague de manifestations de masse a déferlé sur Manille contre l'adoption d'un amendement constitutionnel. Il est à noter que les organisateurs et dirigeants du "parlement des rues" étaient le cardinal X. Sin (évidemment mécontent de la montée du leader protestant en politique) et l'ex-présidente C. Aquino, bien qu'elle ait eu des liens amicaux avec F. Ramos, qui à un moment donné a personnellement dirigé toutes les opérations visant à réprimer les putschs anti-Akinov. Formellement, K. Aquino a défendu l'inviolabilité des lois constitutionnelles. Le 21 septembre 1997, la marche de protestation la plus fréquentée a eu lieu, programmée pour coïncider avec le 25e anniversaire de l'introduction de la loi martiale par F. Marcos. Appréciant le véritable alignement des forces sociales, qui n'est pas en faveur de F. Ramos, il fait une fois de plus preuve de souplesse et de pragmatisme, utilisant l'action protestataire pour se réconcilier publiquement avec l'opposition. S'adressant aux manifestants, il annonce sa décision finale de ne pas briguer un second mandat et de transférer légalement le pouvoir à celui qui sera élu président en mai 1998. En mai 1998, J. Ehercito Estrada (vice-président au F . Ramos), autrefois acteur de cinéma populaire (Estrada est son pseudonyme à l'écran), qui a créé au cinéma l'image d'un certain Philippin Robin Hood, combattant pour la justice et défenseur du "petit homme". Contrairement à F. Ramos, il s'agit d'un type traditionnel d'homme politique, charismatique et populiste qui soutient de toutes les manières possibles l'image d'un «homme des masses» (son deuxième pseudonyme est Erap, en portugais quelque chose comme «ton petit ami»). Il n'était pas un nouveau venu en politique, passant du maire d'une petite ville à la deuxième personne de l'État en vingt ans. Le principal électorat d'Estrada est composé des marginalisés, de l'environnement lumpen, des classes inférieures urbaines et des habitants des bidonvilles. Il était soutenu par des cercles pro-Markos, des hommes d'affaires et des députés du Congrès. Il remporte une victoire électorale facile en mai 1998 (sur 30 millions d'électeurs, 10,7 millions de suffrages sont exprimés pour lui et 4,3 millions pour son rival), même s'il délivre un programme extrêmement vague dominé par des slogans populistes et nationalistes et en même temps des déclarations d'intention de poursuivre le cours réformiste de son prédécesseur. Avec l'arrivée au pouvoir du neuvième président, les prévisions pessimistes de ses adversaires (non seulement les milieux pro-Ramos, mais aussi la majorité de l'élite des affaires, les technocrates, l'intelligentsia, la direction de l'Église catholique66) quant à la réduction du cap vers la modernisation, le déclin de l'économie et l'entraînement de la société dans un nouveau cycle de déstabilisation ont commencé à se réaliser assez rapidement. Un cours a été pris pour la répression sévère de l'opposition extrémiste, ce qui a naturellement conduit à une vague de rébellion de gauche dans les zones chrétiennes, de violence et d'effusion de sang dans le Sud musulman. Mais J. Estrada n'était pas destiné à passer les six années prévues par la constitution dans le fauteuil présidentiel. En 1999 - début 2000, il a été reconnu coupable de corruption à grande échelle, de détournement de fonds, de sombres machinations, portant atteinte à l'économie. Cependant, la longue procédure de destitution de J. Estrada (2000) au Congrès, où il avait de nombreux partisans, s'est déroulée lentement et a généralement menacé d'échouer. Puis le "parlement des rues" a de nouveau pris l'initiative de destituer le président du pouvoir. Les éléments de la population de la capitale qui ont le plus souffert du populisme, de l'incompétence et du manque de scrupules dans les affaires et la politique du chef de l'État (ceux de la classe moyenne, des affaires, des milieux cléricaux, de nombreuses organisations non gouvernementales de la société civile, de l'intelligentsia, etc. ) a participé aux manifestations de masse à Manille. . Mais le paradoxe réside dans le fait que la révolution, "Pouvoir populaire n°2", s'est avérée n'être qu'une répétition farfelue des événements de 1986, puisqu'il s'agissait dans ce cas du renversement du chef politique suprême, bien qu'insolvable , mais démocratiquement élu, de surcroît, à la majorité des suffrages de ses compatriotes. Ainsi, la constitution a été violée de manière flagrante. L'intervention du « parlement de la rue » dans le processus politique d'un pays comme les Philippines, où il existe un profond déséquilibre dans l'interaction du moderne et du traditionnel au sein du système politique, avec un degré extrêmement élevé de personnalisation de la politique et des le manque de formation de structures de parti de type moderne, peut conduire au chaos politique, soulève des doutes quant à la viabilité de la version philippine de la démocratie libérale. Ainsi, les Philippines sont entrées dans le XXIe siècle avec un large éventail de problèmes non résolus, dans une atmosphère de déstabilisation, d'aggravation de l'affrontement « pouvoir-opposition », se transformant en l'un des foyers de violence et d'instabilité dans la région de l'Asie du Sud-Est. dans l'histoire du pays, une femme politique qui a atteint le sommet du pouvoir. Contrairement à J. Estrada, G. Arroyo était un leader réformiste qui a reçu une excellente éducation économique. Après avoir pris la présidence, elle s'est retrouvée au centre de la direction principale de la lutte politique - entre le populisme et le cours vers la poursuite des réformes et la modernisation. Aux élections de 2004, G. Arroyo a remporté une victoire difficile, obtenant le droit légal à une présidence de six ans.
Après avoir accédé à l'indépendance en 1946, les Philippines avaient un système bipartite : le Parti libéral (au pouvoir en 1946-1954 et 1961-1965) et le Parti nationaliste (au pouvoir en 1954-1961 et depuis 1965) étaient au pouvoir. En 1972, l'activité politique a été interdite par le président Ferdinand Marcos, qui a déclaré l'état d'urgence et, en 1978, a créé un nouveau parti au pouvoir, le Mouvement pour une nouvelle société. Après le renversement du régime de Marcos en 1986, un système multipartite a été rétabli. Cependant, l'alignement des forces politiques a changé.
Les forces politiques suivantes opèrent actuellement aux Philippines : "People Power - Christian and Muslim Democrats" - une coalition politique formée en 1992 sous le nom de People Power - National Union of Christian Democrats block, qui a ensuite été rejointe par les United Muslim Democrats of the Philippines fête. Elle était au pouvoir en 1992-1998 (président Fidel Ramos), mais son candidat a été battu à l'élection présidentielle de 1998. Elle est revenue au pouvoir en 2001, lorsque le président Joseph Estrada a été démis de ses fonctions et que les pouvoirs du chef de l'État ont été transférés à la vice-présidente Gloria Macapagal-Arroyo. Lors des élections de 2004, Power of the People - KMD a dirigé la coalition de Truth and Experience for the Future (Four Ks), qui a remporté l'élection présidentielle. Le parti dispose de 93 sièges à la Chambre des représentants et de 7 sièges au Sénat. Dirigeants - Gloria Macapagal-Arroyo (présidente), F. Ramos, Jose de Venezia.
La Nationalist People's Coalition (NPC) est une organisation politique conservatrice fondée avant les élections de 1992. Depuis 2000, elle soutient le gouvernement de Gloria Macanagal-Arroyo, et rejoint la coalition Four K. A 53 sièges à la Chambre des représentants. Dirigeants - Eduardo Cojuangco, Frisco San Juan.
Parti libéral (LP) - fondé en 1946. Il fait partie de l'Internationale libérale, membre de la coalition au pouvoir Four K. Il compte 34 sièges à la Chambre des représentants et 3 sièges au Sénat. Dirigeants - Franklin Drilon, José Atienza.
Le Parti nationaliste est le plus ancien parti politique du pays, fondé en 1907 et menant la lutte pour l'indépendance des Philippines. Adopte une position conservatrice. Il est membre de la coalition au pouvoir Four K. Chef - Manuel Villar.
Parti réformateur du peuple (PRP) - formé avant les élections de 1992 pour soutenir la candidature présidentielle de l'ancienne juge Maria Defensor-Santiago, devenue célèbre pour sa lutte contre la corruption. Il est membre de la coalition au pouvoir Four K. Aux élections de 2004, elle a obtenu 1 des 12 sièges élus au Sénat.
Le Fighting Democratic Philippinos (BDF) est un parti conservateur qui s'est formé en 1988 comme principal soutien de la présidente Corazon Aquino (1986-1992). En 1992, le parti a été battu aux élections, bien qu'il ait conservé son influence au Congrès. En 2003, il s'est scindé en factions d'Edgaro Angara et d'Aquino-Panfilo Lacson. Lors des élections de 2004, la faction Angara a dirigé l'opposition United Filipinos Coalition. La faction de Lakson a agi de manière indépendante. Le parti dispose de 11 sièges à la Chambre des représentants. Lors des élections de 2004, la faction Angara a remporté 1 des 12 sièges élus au Sénat.
Le Philippine Mass Party (PFM) est un parti populiste fondé au début des années 1990 par des partisans du célèbre acteur Joseph Estrada (président du pays en 1998-2001). En 2001, elle passe dans l'opposition, en 2004 elle rejoint la United Philippinos Coalition, possède 2 sièges au Sénat. Dirigeants - Joseph Estrada, Juan Ponce Enrile.
Le Parti démocrate philippin - Lutte est un parti centriste fondé en 1982. En 2004, elle a rejoint l'opposition United Filipinos Coalition et a remporté 1 des 12 sièges élus au Sénat. Chef - Aquilino Pimentel.
L'Alliance de l'espoir est une coalition d'opposition créée pour les élections de 2004 par les partis centristes qui ont soutenu la présidente Gloria Macapagal-Arroyo jusqu'en 2003. Il comprenait le Parti d'action démocratique (dirigeant - Paul Roco), le Parti de la réforme (dirigeant - Renato de Villa) et le Parti pour le développement primaire des provinces (dirigeant - Lito Osmeña).
Les partis suivants opèrent également légalement : le Mouvement « Arise, Philippines » (dirigeant - Eduardo Villanueva), le Parti « One Nation, One Spirit » (dirigeants - Rodolfo Pajo, Eddie Gil), le Mouvement pour une nouvelle société (parti d'anciens partisans de F. Marcos), Parti progressiste centriste, Parti vert, Parti de l'action civile de gauche, Nation First (branche légale du Parti communiste, formé en 1999), Parti des travailleurs, Parti travailliste révolutionnaire trotskyste, etc.
Le Filigtin Communist Party (CPF) est un parti maoïste fondé en 1968 par des groupes dissidents du Parti communiste pro-soviétique (créé en 1930). Il milite sous les slogans du marxisme-léninisme, mène une lutte armée insurrectionnelle pour renverser le régime actuel des Philippines. Il dirige la "Nouvelle armée populaire", qui compte jusqu'à 11 000 combattants et opère principalement sur l'île de Luzon.
Août 2010
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PAYS.
Les Philippins qualifient souvent leur nation d'"hybride de feu et d'eau". "Qu'attendez-vous de nous? Nous avons vécu dans un couvent espagnol pendant près de quatre cents ans et à Hollywood pendant un demi-siècle. Nos ancêtres nous ont donné l'ouverture d'esprit, les Chinois nous ont donné la retenue, les Espagnols nous ont donné les fêtes, les Américains nous ont donné le goût des affaires. Eh bien, nous avons hérité du goût de la vie et de la dignité de nos ancêtres.
RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES.
Philippines- une république présidentielle avec un congrès bicaméral et un pouvoir judiciaire indépendant. |
|
|
Il a été maire de la ville de Davao sur l'île de Mindanao pendant 7 mandats, pour un total de plus de 22 ans. Il a également été vice-maire de la ville et membre du Congrès philippin. |
Rodrigo Duterte est né le 28 mars 1945 sur l'île de Leyte dans la ville de Maasine (province de Leyte du Sud) dans la famille de Vicente Duterte, gouverneur de la province de Davao, et de Soledad Roa, instituteur et personnage public. Ses parents sont d'ethnie Cebuano et son grand-père maternel est un migrant chinois du Fujian. Duterte, surnommé "The Executioner" par le magazine Time, a été critiqué à plusieurs reprises par des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International, pour avoir soutenu des exécutions sommaires de criminels qui auraient été menées par des "escadrons de la mort de Davao". En avril 2009, un rapport à la 11e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré; "Le maire de Davao n'a rien fait pour empêcher ces meurtres, et ses commentaires publics donnent l'impression qu'il les soutient." Selon un rapport de HumanRightsWatch, en 2001-2002, Duterte a nommé un certain nombre de criminels dans des programmes de radio et de télévision, dont certains ont ensuite été tués. En juillet 2005, lors d'un sommet sur la lutte contre la criminalité, l'homme politique a déclaré : "Les exécutions rapides de criminels restent le moyen le plus efficace de lutter contre les enlèvements et le trafic de drogue". En 2015, Duterte a confirmé le lien entre lui et les meurtres de criminels sans procès à Davao, et a également déclaré que s'il devenait président, il exécuterait jusqu'à cent mille criminels. |
|
ARCHIPEL PHILIPPIN.
Les Philippines sont un archipel tropical de 7 107 îles situées en Asie du Sud-Est. La longueur de l'archipel est d'environ 800 km d'est en ouest et d'environ 1900 km du nord au sud. La superficie totale des îles est de 300 000 km. Les plus grandes îles : Luzon - la plus grande - au nord et Mindanao - la deuxième plus grande île avec 400 petites îles adjacentes au sud. Entre les deux se trouve le groupe Visayas de plus de 6 000 îles, dont Panay, Leyte, Samar, Cebu et Bohol, mais beaucoup d'entre elles n'ont même pas de nom. Palawan est la plus grande île de l'ouest.
Les îles sont baignées par les eaux de l'océan Pacifique, la mer de Chine méridionale, la mer de Sulawesi, au nord les Philippines sont séparées de l'île de Taiwan par le détroit de Bashi.
Pour faciliter la navigation, vous trouverez ici toutes les cartes des Philippines allant des cartes historiques aux cartes modernes par pays, régions, villes. COLLECTION DE CARTES DES PHILIPPINES>>>
POPULATION.
Depuis juillet 2010 Les Philippines ont une population de 99,9 millions d'habitants et se classent au 12e rang mondial.
Population urbaine 68% (données 2002)
Croissance démographique annuelle - 1,9 %
La densité de population est de 272 personnes pour 1 km². kilomètres
CAPITALE DES PHILIPPINES.
MANILLE est la plus grande ville des Philippines. Situé sur une île Luçon, au confluent de la rivière Pasig en baie de manille Mer de Chine méridionale. La ville a été fondée le 24 juin 1571 par López de Legazpi. Sur la rive sud de la rivière Pasig se trouve la partie la plus ancienne de la ville - le quartier - Intra-muros(littéralement "muré") Il a été construit par les Espagnols en 1571, des familles majoritairement hispaniques vivaient dans ses murs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été détruit, mais a ensuite été restauré. Il conserve encore quelques exemples de l'ancienne architecture espagnole. Tout d'abord, c'est un mur de forteresse dont la construction a commencé en 1590. L'entrée de la forteresse de Santiago ravive le souvenir de la présence espagnole. Sa population moderne est d'environ 5 000 personnes.
En 1595, Manille devient la capitale de tous Archipel des Philippines, ainsi que le centre de la province, qui occupait à l'origine presque tout Luzon.
Au cours de l'histoire, Manille a connu de nombreuses guerres, à la suite desquelles de nombreux monuments architecturaux, historiques et culturels ont été détruits. Aujourd'hui, Manille est un centre culturel majeur, où se concentrent plusieurs universités.
Centre économique, politique, culturel, capitale de l'État. Population 1.660.714 (2007) Banlieue 12.285.000 (2005) Est l'une des villes avec la densité de population la plus élevée au monde.
LANGUE.
Le pays a deux langues officielles, le pilipino (basé sur le tagalog) et l'anglais. L'espagnol et le chinois sont également courants. L'espagnol est parlé aux Philippines depuis plus de trois siècles. À Manille et dans les environs, la langue principale est le taglish (un mélange de tagalog et d'anglais).
Pilipinno (Tagalo)- huit principaux dialectes parlés par la plupart des Philippins : Tagalog, Cebuano, Ilocan, Hiligaynon ou Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango et Pangasinense.
Le philippin est la langue maternelle utilisée pour communiquer la communication entre les groupes ethniques. Il existe environ 76 des 78 principaux groupes linguistiques, avec plus de 500 dialectes.
langue Anglaise- a obtenu sa distribution pendant l'occupation américaine depuis 1899 après la guerre hispano-américaine.Il est largement utilisé aujourd'hui. Il est enseigné dans les écoles et est également la langue d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur.
Les Philippines sont actuellement le troisième plus grand pays anglophone du monde.
L'alphabétisation- 93% (selon le recensement de 2000).
Composition ethnique- Tagalog 28,1%, Sebuyano 13,1%, Ilocano 9%, Binisaya 7,6%, Hiligayon 7,5%, Bikol 6%, Warai 3,4%, autres 25,3% (selon le recensement de 2000) .
SYSTÈME ÉDUCATIF.
Le système de scolarisation gratuite introduit par les Espagnols en 1863 a été complété par le Collège pédagogique créé par décision du gouvernement américain et de l'Université d'État des Philippines. Tout au long de la période de dépendance politique du pays vis-à-vis des États-Unis et jusqu'au milieu des années 1970, l'éducation était le poste le plus important du budget de l'État philippin. En 1972, la réforme du système éducatif a commencé afin de le mettre en conformité avec les exigences modernes. Dans les nouveaux programmes, une attention particulière est accordée à l'enseignement professionnel. En plus de l'anglais, l'enseignement pouvait désormais être dispensé en langue pilipino (tagalog) et sur l'île de Mindanao, il était permis d'utiliser l'arabe. En 1990, plus de 90 % de la population du pays âgée de plus de 14 ans était alphabétisée.
La durée de l'enseignement à l'école élémentaire est de 6 ans, et à l'école secondaire et au collège - 4 ans chacun. L'enseignement secondaire et supérieur aux Philippines est dispensé principalement dans des établissements d'enseignement privés. Le système d'enseignement supérieur aux Philippines suit le modèle américain. Il peut être obtenu gratuitement dans les universités et collèges publics, ainsi que dans les écoles normales ou techniques. Environ un tiers de tous les établissements d'enseignement privés sont sous le patronage de l'Église catholique romaine et environ 10 % sont associés à d'autres organisations religieuses. Les établissements d'enseignement supérieur fonctionnent dans presque toutes les provinces, mais la plupart d'entre eux sont situés dans le Grand Manille. Université d'État Philippines à Quezon City, ouvert en 1908, compte un grand nombre de facultés et de collèges. Le prestige est également apprécié par l'Université catholique de Santo Tomas (fondée en 1611), l'Université d'Extrême-Orient de Manille, l'Université de Manille, l'Université Adamson, l'Université Ateneum, l'Université des femmes des Philippines et l'Université de Mindanao à Marawi City, située dans la zone métropolitaine de Manille. Des missionnaires américains ont fondé l'Université Sillimanan à Dumaguete et l'Université centrale des Philippines à Iloilo.
COMPOSITION CONFESSIONNELLE DE LA POPULATION.
RELIGION.
Historiquement, les Philippines ont uni les deux grandes religions du monde - le christianisme et l'islam.
Islam- a été introduit au XIVe siècle après l'expansion des relations commerciales avec les Arabes en Asie du Sud-Est. Actuellement, l'islam est pratiqué principalement dans les régions du sud du pays.
Christianisme- au XVIe siècle avec l'arrivée de Ferdinand Magellan en 1521. Les Espagnols ont apporté le christianisme aux Philippines (foi catholique romaine) Au moins 83% de la population totale appartient à l'Église catholique romaine..
catholiques – 80.9%
Protestants – 9.6%
Islam - 4,6%
Église indépendante des Philippines - 2,6%
L'Église du Christ- 2,3% (Iglesia ni Cristo, INC, anciennement Iglesia ni Kristo) la plus grande église philippine indépendante. Fondée en 1914 par Félix Manalo)
PEUPLES CHRETIENS- les mariages mixtes et les migrations internes au fil des ans ont considérablement atténué les anciennes différences entre les groupes ethniques chrétiens. Le nom de chacun d'eux, à quelques exceptions près, correspond à la langue utilisée. Les Tagals, qui vivent dans le centre et le sud de Luzon, dominent le Grand Manille et représentent environ un quart de la population des Philippines.
Les Cebuanos dominent les îles de Cebu, Bohol, Negros East, Leyte West et les zones côtières de Mindanao. Initialement gravitant vers la partie nord de Luzon, les Iloks (Ilokans) ont ensuite migré en masse vers les régions centrales de cette île ou se sont déplacés vers les États-Unis. Les Hiligaynons (Ilongo) vivent sur l'île de Panay, ainsi qu'à l'ouest de l'île de Negros et au sud de l'île de Mindoro, c'est-à-dire dans les principales régions productrices de canne à sucre. De nombreux Ilongo se sont installés sur l'île de Mindanao, où ils sont entrés en conflit avec sa population musulmane.
Les Bicols sont considérés comme originaires du sud-est de Luzon et des îles voisines. La partie principale du Bisaya (Visaya) est concentrée dans les Visayas orientales, l'île de Samar et à l'est de l'île de Leyte. Les Pampangans vivent dans le centre de Luzon (principalement dans la province de Pampanga) et les Pangasinans vivent dans la bande côtière de la baie de Lingayen sur l'île de Luzon, d'où ils se sont propagés à l'intérieur de l'île.
La famille est considérée comme la cellule de base de la société. De nombreux parents - généralement jusqu'à des cousins au quatrième degré - forment le cercle restreint de chaque Philippin. L'entraide et la responsabilité mutuelle se développent entre proches. La conclusion de mariages apparentés est rarement autorisée et l'élargissement du cercle des "parents" se fait souvent par l'intermédiaire de parents spirituels qui participent au rite catholique du baptême de l'enfant. Les parrains et marraines ne sont parfois pas moins importants dans la vie d'un Philippin que les parents les plus proches.
Une femme s'occupe des enfants et du ménage, contrôle le budget familial et peut parfois être le principal soutien de famille. Les représentants du sexe faible participent à la politique et aux affaires, acquièrent diverses professions. Pour des types de travail comparables, les femmes reçoivent généralement des salaires inférieurs. Les divorces et les avortements sont interdits.
De nombreux chrétiens locaux croient que toute relation doit être épanouissante et que, par conséquent, les conflits et les désaccords doivent être évités. À leur avis, pour atteindre le bonheur et réussir dans la vie, une personne doit faire preuve de patience, d'endurance et même endurer la souffrance. La tâche la plus importante de la vie de tout chrétien philippin est d'observer le principe de « utang na loob » : après avoir accepté un service volontaire ou l'aide de quelqu'un, il naît une obligation morale de répondre à la demande en retour - une sorte de dette qui ne peut être remboursé avec de l'argent.
Les chrétiens philippins croient généralement à l'existence d'esprits, de sorcières et au pouvoir de toutes sortes de sorts magiques. Dans les villages, les malades ont souvent recours à l'aide de guérisseurs locaux. La vie sociale des habitants du village est formée sur la base du calendrier de l'église, de la fête annuelle en l'honneur du saint patron, du programme culturel de l'école locale, ainsi que de la célébration d'événements tels que le baptême des bébés et le mariage des jeunes mariés.
POPULATIONS MUSULMANES- les adeptes de l'islam sont concentrés principalement dans la partie sud de Mindanao et l'archipel de Sulu. Au total, il existe une douzaine de peuples musulmans différents dans le pays, dont les plus nombreux sont les Maguindanao, ainsi que les Sulu (Tausog), les Maranao et les Samal. Les Sulu, vivant sur l'archipel du même nom (principalement sur l'île de Jolo), furent les premiers à se convertir à l'islam. Les Maranao ("peuple du lac") se sont installés sur les rives du lac Lanao sur l'île de Mindanao. Maguindanao s'est installé dans les plaines du nord de Cotabato sur le même Mindanao. Les artisans de Maranao et de Maguindanao sont réputés pour leur travail du cuivre et du bronze. Dans la partie sud de l'archipel de Sulu vivent Samal - le plus pauvre des peuples musulmans locaux ; les bateaux servent d'habitations à certaines familles Samal. Plus petits que les autres yakans sur l'île de Basilan, Bajau sur l'archipel de Sulu, Sangila dans les provinces de Davao et Cotabato à Mindanao.
La plupart des Maranao et des Maguindanao sont des paysans qui cultivent du riz, du manioc, du cocotier et d'autres cultures. De nombreux habitants le long de la côte de Sulu, Samal et Bajau vivent de la pêche, transportant eux-mêmes des passagers et des marchandises. bateaux à moteur(kumpit) Certains commerces de contrebande et de piraterie, à cause desquels ils entrent souvent en conflit avec la loi. Les habitations des musulmans et des chrétiens philippins dans leur ensemble ne diffèrent pas de manière significative ni par le style ni par les matériaux de construction utilisés, bien qu'à certains endroits sur l'île de Jolo et dans la région du lac. Maisons de Lanao aux toits pentus et aux poutres apparentes avec une abondance d'éléments décoratifs (oiseaux sculptés, serpents, dragons, etc.).
À l'arrivée des Espagnols, il y avait plusieurs sultanats musulmans aux Philippines, dont le plus puissant était Sulu. Son territoire couvrait non seulement les îles de l'archipel, mais aussi une partie du nord de Bornéo (Sabah moderne). Le soutien du monarque et de sa cour, qui comprenait le premier ministre, les gouverneurs des terres et d'autres fonctionnaires, était composé de chefs de communauté - la date (ou dato), à laquelle tout musulman devait obéir. Datu, à son tour, a prêté serment d'allégeance au sultan. Les échelons inférieurs de l'échelle sociale étaient occupés par des membres ordinaires de la communauté et, au bas de la société, des esclaves. À l'heure actuelle, les Datu restent des chefs de village dotés de pouvoirs spirituels et temporels particuliers.
Conformément à la tradition islamique locale, le premier missionnaire arabe aux Philippines est apparu sur l'île de Jolo en 1380. De l'archipel de Sulu, un nouvel enseignement religieux s'est répandu sur l'île de Mindanao. En 1745, une communauté musulmane est née à l'embouchure de la rivière Mindanao. Au moment où les Espagnols sont arrivés, l'Islam s'était déplacé vers le nord et avait atteint le centre de Luzon. Après la défaite par les Espagnols en 1571 des troupes de son souverain, Raja Suleiman, la confession musulmane est repoussée vers le sud des Philippines.
MONTAGNE ETHNOIS- les habitants autochtones du pays, habitant des territoires aussi isolés que la province montagneuse au nord de Luzon, les îles Palawan, Mindoro et Mindanao, n'ont pas subi d'influence espagnole ou musulmane significative. Il y a plus de 100 petits peuples montagnards aux Philippines, allant de quelques centaines à plus de 100 000 personnes. Certains des membres de ces communautés ethniques s'identifient comme catholiques ou musulmans, tandis que de nombreux autres adhèrent aux croyances traditionnelles locales.
Les principaux groupes tribaux qui se sont installés dans le nord de Luzon sont les Ibaloi, Kankanai, Ifugao, Bontoc, Kalinga, Apayo (Isnegi), Tinguian, Gaddan et Ilongot. Les Mangians vivent sur l'île de Mindoro, et les Tagbanua, Palawans et Bataks vivent sur Palawan. Mindanao est devenu le foyer de Bagobo, Bilaans, Bukidnons, Mandaya, Manobo, Subanons, T "Boli et Tirurai. Des représentants du groupe Aeta (ou Negrito) se trouvent sur les îles de Luzon, Mindanao, Negros et Panay.
De nombreuses tribus pratiquent l'agriculture sur brûlis, défrichant une parcelle de forêt en abattant et en brûlant les arbres qui y poussent. petits arbres et arbustes. Ensuite, diverses cultures sont cultivées sur la parcelle résultante pendant plusieurs années, et une fois le sol épuisé, tout le cycle est répété dans un nouvel endroit. Le riz, le maïs, les patates douces, le taro, certains fruits et légumes sont ainsi récoltés. Certains petits peuples, comme les Ifugao, pratiquent une agriculture irriguée en terrasses. Dans le village de Banaue dans la province montagneuse de Luzon, les pentes abruptes descendant dans la vallée de la rivière sont un escalier géant de terrasses utilisées pour les cultures de riz. Certaines terrasses ont des murs de soutènement en pierre, atteignant une hauteur de 6 mètres. Poissons, crevettes, crabes, coquillages sont pêchés dans les rizières inondées et dans les eaux vives. Ils élèvent des buffles et des cochons. L'élevage de poulets est largement pratiqué. Les chiens sont souvent utilisés pour chasser et garder la maison. Les paniers et les nattes sont tissés à partir de bambou, de rotin et de feuilles de palmier, et les vêtements sont fabriqués à partir de tissus de coton produits localement. Les femmes portent généralement un sari et les hommes un pagne, mais certains groupes tribaux, comme les Bagobo, préfèrent porter le même style de pantalon porté par les Philippins musulmans à Mindanao.
Dans différentes régions du pays, notamment au nord de Luçon, un ou plusieurs villages apparentés servent en quelque sorte de centre culturel à de nombreux groupes tribaux. Dans de rares cas, par exemple, chez les Subanons, un système de peuplement dispersé de type agricole prévaut. Les cabanes sont souvent construites sur pilotis ; le sol et les murs sont en bambou, parfois en bois, et le toit est recouvert de feuilles de palmier ou de paille. Bontoks, Kankanai et Inibaloi construisent leurs habitations à même le sol.
La religion de tous les groupes ethniques montagnards comprend des systèmes complexes de croyances en divers esprits, divinités principales et autres, ainsi que la pratique rituelle correspondante. Bagobo, par exemple, vient de l'existence de neuf cieux, dont chacun a son propre dieu. Les rites sont exécutés principalement pour apaiser les esprits qui causent la maladie.
SPORT.
Les sports préférés sont les combats de coqs et le basket-ball. Les Philippins ont remporté de grands succès en boxe (catégories poids léger et poids plume). La Fédération d'athlétisme amateur envoie régulièrement ses athlètes participer aux Jeux asiatiques et olympiques. De plus, les échecs sont extrêmement populaires aux Philippines, le champion philippin Eugenio Torre est le premier citoyen d'un pays asiatique à recevoir le titre de grand maître.
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉTAT.
Depuis le moment où les Philippines ont obtenu leur indépendance en 1946 jusqu'en 1972, lorsque le président Ferdinand Marcos a promulgué un décret sur l'instauration de l'état d'urgence, le pays était gouverné par une constitution qui prévoyait la participation à ce processus du chef de l'État, du congrès et le tribunal. En 1973, une nouvelle constitution a été adoptée, conformément aux dispositions spéciales dont Marcos a reçu des pouvoirs supplémentaires, qui sont restés jusqu'à la levée de l'état d'urgence aux Philippines en 1981. Malgré la restauration formelle d'une forme démocratique de gouvernement, un le référendum populaire tenu la même année a amendé la constitution de 1973, élargissant les prérogatives du président. Lorsque Marcos a été renversé en février 1986, le gouvernement de Corazon Aquino a déclaré la constitution de 1973 nulle et non avenue et a nommé une commission pour rédiger une nouvelle constitution. Le 2 février 1987, la nouvelle constitution a été approuvée lors d'un référendum populaire et est entrée en vigueur 9 jours plus tard.
AUTORITÉS CENTRALES.
Les Philippines sont une république présidentielle depuis 1987 avec un congrès bicaméral et un pouvoir judiciaire indépendant.
Le président des Philippines détient le pouvoir exécutif suprême (l'âge d'élection n'est pas inférieur à 40 ans, résidence aux Philippines depuis au moins 10 ans avant l'élection).
Le président exerce simultanément les fonctions de chef du gouvernement et de commandant en chef des forces armées. Le président (et avec lui le vice-président) est élu au suffrage universel des citoyens âgés de 18 ans et plus pour un mandat de 6 ans. En principe, il n'est pas rééligible pour un nouveau mandat, sauf si le chef de l'État a pris ses fonctions à la suite de la destitution constitutionnelle de l'ancien président et l'a occupé pendant 4 ans au maximum.
Le Président (avec le consentement de la Commission des nominations) nomme les membres du Cabinet des ministres qu'il dirige. Depuis le 30 juin 2010, le président des Philippines est Benigno Aquino Jr. En même temps que le président, lors d'élections séparées, le vice-président du pays est élu au suffrage universel. Son mandat est de 6 ans. Il peut être réélu pour un second mandat.
Les principes de l'administration publique reposent sur l'élection des organes gouvernementaux et la séparation de ses pouvoirs - législatif, exécutif, judiciaire.
L'organe législatif suprême est le Congrès bicaméral.
La chambre haute - le Sénat (24 sénateurs âgés d'au moins 35 ans), est élue pour 6 ans avec des élections intermédiaires tous les 3 ans et le droit de réélection pour un second mandat. Le chef de la chambre haute est le président du sénat, qui est élu par les sénateurs. La Chambre des représentants (chef - président) est élue pour 3 ans, composée de 250 députés au maximum (à partir de 25 ans) avec un droit de réélection pour 3 mandats.
Parmi eux, 212 sont élus dans des circonscriptions uninominales. Les autres (actuellement 24 membres) sont nommés par le président conformément aux listes des partis dans un système complexe en fonction du nombre de voix reçues par les partis lors des élections. Le président des Philippines peut opposer son veto aux projets de loi approuvés par le Congrès ou à des articles individuels de ceux-ci. Un vote des deux tiers des deux chambres du Congrès est nécessaire pour annuler un veto.
AUTORITÉS LOCALES.
Les Philippines sont divisées en 17 régions économiques et administratives (régions) qui se composent de 79 provinces et de 116 villes autonomes. Pour faciliter la planification. développement et coordination des activités administratives de la province fusionnée en municipalités, barangay (districts ruraux)
Parmi ces régions, deux ont un statut autonome : la Région musulmane autonome de Mindanao (regroupe 4 provinces - Maguindanao, South Lanao, Sulu, Tawitawi) et dans les montagnes de la Cordillère centrale au nord de Luzon. Une zone distincte est le Grand Manille.
Les provinces sont gouvernées par des conseils élus dirigés par des gouverneurs. Les régions - à l'exception des régions autonomes - n'ont pas leur propre administration. Les provinces, à leur tour, sont divisées en villes et municipalités. Comme les villes autonomes, elles sont gouvernées par des conseils dirigés par des maires. Les municipalités (environ 1.495) et les villes se composent de barangays (l'unité administrative locale la plus basse, comprenant un ou plusieurs villages ou villes. Environ 42.000)
PARTIS POLITIQUES.
Après avoir accédé à l'indépendance en 1946, les Philippines avaient un système bipartite : le Parti libéral (au pouvoir en 1946-1954 et 1961-1965) et le Parti nationaliste (au pouvoir en 1954-1961 et depuis 1965) étaient au pouvoir. En 1972, l'activité politique a été interdite par le président Ferdinand Marcos, qui a déclaré l'état d'urgence et, en 1978, a créé un nouveau parti au pouvoir, le Mouvement pour une nouvelle société. Après le renversement du régime de Marcos en 1986, un système multipartite a été rétabli. cependant, l'alignement des forces politiques a radicalement changé.
Pouvoir du peuple - Démocrates chrétiens et musulmans- une coalition politique formée en 1992 sous le nom de bloc Pouvoir populaire - Union nationale des démocrates-chrétiens, qui a ensuite été rejointe par le parti des Démocrates musulmans unis des Philippines. Elle était au pouvoir en 1992-1998 (président Fidel Ramos), mais son candidat a été battu à l'élection présidentielle de 1998. Elle est revenue au pouvoir en 2001 lorsque le président Joseph Estrada a été démis de ses fonctions et que les pouvoirs du chef de l'État ont été transférés à la vice-présidente Gloria Macapagal-Arroyo. Lors des élections de 2004, « Le pouvoir du peuple - KMD » était à la tête du bloc « Coalition de la vérité et de l'expérience pour l'avenir » (« Quatre K »), qui a remporté l'élection présidentielle. Le parti dispose de 93 sièges à la Chambre des représentants et de 7 sièges au Sénat. Dirigeants - Gloria Macapagal-Arroyo (présidente), F. Ramos, Jose de Venezia.
Coalition populaire nationaliste (NPC)- une organisation politique conservatrice fondée avant les élections de 1992. Depuis 2000, elle soutient le gouvernement de Gloria Macapgal-Arroyo, et rejoint la coalition Four K. A 53 sièges à la Chambre des représentants. Dirigeants - Eduardo Cojuangco, Frisco San Juan.
Parti libéral (LP)- formé en 1946. Membre de l'Internationale libérale, membre de la coalition au pouvoir "Four K". Il compte 34 sièges à la Chambre des représentants et 3 sièges au Sénat. Dirigeants - Franklin Drilon, José Atienza.
Le Parti nationaliste est le plus ancien parti politique du pays, fondé en 1907 et menant la lutte pour l'indépendance des Philippines. Adopte une position conservatrice. Il est membre de la coalition au pouvoir Four K. Chef - Manuel Villar.
Parti populaire de la réforme (PNR)- formé avant les élections de 1992 pour soutenir la candidature présidentielle de l'ancienne juge Maria Defensor-Santiago, devenue célèbre pour lutter contre la corruption. Il est membre de la coalition au pouvoir Four K. Aux élections de 2004, elle a remporté 1 des 12 sièges élus au Sénat.
Combattre les Philippins démocrates (BDF)- conservateur, a pris forme en 1988 comme principal soutien de la présidente Corazon Aquino (1986 - 1992). En 1992, le parti a été battu aux élections, mais a conservé son influence au Congrès. En 2003, il s'est scindé en factions d'Edgaro Angara et d'Aquino-Panfilo Lacson. Lors des élections de 2004, la faction Angara a dirigé l'opposition United Filipinos Coalition. La faction de Lakson a agi de manière indépendante. Le parti dispose de 11 sièges à la Chambre des représentants. Lors des élections de 2004, la faction Angara a remporté 1 des 12 sièges élus au Sénat.
Parti de masse philippin (PFM)- populiste, créé au début des années 1990 par des partisans du célèbre acteur Joseph Estrada (président du pays en 1998-2001). En 2001, elle passe dans l'opposition, en 2004 elle rejoint la United Philippinos Coalition, possède 2 sièges au Sénat. Dirigeants - Joseph Estrada, Juan Ponce Enrile.
Parti démocrate philippin - Lutte- parti centriste, fondé en 1982. En 2004, elle rejoint l'opposition "Coalition of United Filipinos", remporte 1 des 12 sièges élus au Sénat. Chef - Aquilino Pimentel.
Alliance de l'espoir- une coalition d'opposition créée pour les élections de 2004 par des partis centristes, qui soutenaient jusqu'en 2003 la présidente Gloria Macapagal-Arroyo. Il comprenait le Parti d'action démocratique (dirigeant - Paul Roco), le Parti de la réforme (dirigeant - Renato de Villa) et le Parti pour le développement primaire des provinces (dirigeant - Lito Osmeña).
Il y a aussi des fêtes :
Mouvement Arise Philippines (leader - Eduardo Villanueva),
Parti "Une Nation, Un Esprit" (dirigeants - Rodolfo Pajo, Eddie Gil),
Mouvement pour une nouvelle société (parti des anciens partisans de F. Marcos)
centriste- Parti progressiste, Parti vert, Parti de l'action civile de gauche, Nation First (branche légale du Parti communiste, formé en 1999), Parti des travailleurs, Parti travailliste révolutionnaire trotskyste et autres.
Parti communiste des Philippines (PCF)- Maoïste, créé en 1968 par des groupes en rupture avec le Parti communiste pro-soviétique (créé en 1930). Il milite sous les slogans du marxisme-léninisme, mène une lutte armée insurrectionnelle pour renverser le régime actuel des Philippines. Il dirige la "Nouvelle armée populaire", qui compte jusqu'à 11 000 combattants et opère principalement sur l'île de Luzon.
Organisations séparatistes(dans le sud du pays, dans les régions musulmanes de Mindanao, etc.) : Front de libération nationale Moro (FNOM, créé en 1969, groupe modéré qui a signé un accord avec le gouvernement philippin en 1987, et en 1996 a accepté de créer une région autonome dirigée par le chef du front Nur Misuari), le Front de libération islamique Moro (séparation du FOLM en 1978, prône la création d'un État islamique Moro indépendant, mène une lutte armée, s'appuyant sur 11 à 15 000 combattants; chef - Istaz Salami Hashim ), Abu Sayyaf Group (dissocié en 1991 de la FNOM ; représente l'État islamique et recourt à des méthodes de lutte terroristes ; le leader est Abdurazhik Abubarak Janjalani).
SYSTÈME JUDICIAIRE.
La plus haute instance judiciaire est la Cour suprême. Ses membres (juge en chef et 14 membres) sont nommés par le président des Philippines sur proposition du conseil des juges et des avocats. La Cour suprême est également habilitée à déterminer la constitutionnalité des lois adoptées et la légalité des actions du gouvernement. Il existe également une cour d'appel et un tribunal spécial qui connaît des affaires de corruption dans les institutions publiques (Sandigan Bayan). La possibilité de former des commissions indépendantes pour les élections, les audits et les révisions, etc. est envisagée. Les systèmes judiciaires subordonnés opèrent au sein des divisions civiles des Philippines.
POLICE ÉTRANGÈRE.
Les Philippines sont membres de l'ONU et de ses organisations spécialisées, ainsi que d'associations et d'organismes régionaux internationaux - ASEAN, Banque asiatique, Conférence économique Asie-Pacifique, etc. Ils entretiennent des relations diplomatiques avec la Russie (établie avec l'URSS en 1976).
En politique étrangère, les Philippines se sont traditionnellement orientées vers les États-Unis, avec lesquels un traité militaire a été conclu en 1952. Mais depuis les années 1980, les autorités du pays ont essayé de prendre un cours plus indépendant dans les affaires internationales et de diversifier les relations bilatérales dans la région. En 1992, les bases militaires américaines de Clark Field et de Subic Bay ont été fermées. Malgré la persistance de différends territoriaux avec un certain nombre d'États d'Asie de l'Est et du Sud-Est (avec la Chine, Taïwan et le Vietnam - sur la propriété des îles Spratly riches en pétrole et en gaz dans la mer de Chine méridionale, avec la Malaisie - sur la propriété de Sabah ), les Philippines développent une coopération avec les pays voisins de la région. La coopération militaire avec les États-Unis s'est encore intensifiée au début des années 2000 dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » déclarée par les États-Unis. Les pays coopèrent dans la lutte contre le groupe islamiste Abu Sayyaf. Les Philippines ont envoyé leurs unités militaires en Irak.
ÉTABLISSEMENT MILITAIRE.
Les forces armées philippines se composent de l'armée, de la marine (y compris la garde côtière et les marines) et de l'armée de l'air. Le nombre total - St. 100 000. Service militaire - à partir de 18 ans (obligatoire et volontaire). Il existe également des formations territoriales d'unités de protection civile et de police. Environ. 1,5 % du PIB.
MÉDIAS DE MASSE.
Il existe 225 stations de télévision et plus de 900 stations de radio aux Philippines. Le pays compte 11,5 millions de radios et 3,7 millions de télévisions. Dans la capitale, env. 30 journaux, principalement en anglais, quelques-uns en philippin et 4 en chinois. Des journaux sont également publiés dans les provinces. Le tirage du Philippine Daily Inquirer, le plus important des journaux de la capitale, en semaine est supérieur à 280 000 exemplaires.
Plusieurs studios de cinéma opèrent à Manille, où les films sont réalisés en anglais et en tagalog pour un public local.
ÉCONOMIE
Avant la Seconde Guerre mondiale, l'économie philippine reposait principalement sur l'agriculture et la foresterie. Dans la période d'après-guerre, l'industrie manufacturière a commencé à se développer et à la fin du XXe siècle. c'est aussi l'industrie des services. Cependant, dans le domaine économique, le pays était à la traîne de nombreux autres États d'Asie de l'Est, notamment en raison de fortes inégalités sociales, de la corruption généralisée de la bureaucratie et de la nature dépendante de son économie. A la fin du 20ème siècle Les Philippines ont connu une croissance économique modérée tirée par les envois de fonds des Philippins de l'étranger, le développement des technologies de l'information et la disponibilité d'une main-d'œuvre bon marché.
La crise financière asiatique de 1997 a fait peu de dégâts aux Philippines ; les envois de fonds des Philippins travaillant à l'étranger (6 à 7 milliards de dollars par an) ont été un soutien important. Au cours des années suivantes, l'économie du pays a commencé à s'améliorer: si en 1998 le PIB a chuté de 0,8%, en 1999, il a augmenté de 2,4% et en 2000 de 4,4%. En 2001, la croissance a de nouveau ralenti à 3,2 % en raison du ralentissement économique mondial et de la baisse des exportations. Plus tard, grâce au développement du secteur des services, à une augmentation de la production industrielle et à la promotion des exportations, le PIB a augmenté de 4,4 % en 2002 et de 4,5 % en 2003. De graves problèmes pour l'économie philippine demeurent la répartition inégale des revenus, des niveaux élevés de pauvreté (en 2001, environ 40% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté) et lourdement endettée (la dette publique est de 77% du PIB). St. 11% de la population active sont au chômage.
En 2003, le PIB était estimé à 390,7 milliards de dollars, soit 4 600 dollars par habitant. Dans le même temps, la part de l'agriculture dans la structure du PIB est de 14,5%, l'industrie - 32,3%, les services - 53,2%. Sur près de 35 millions d'employés, 45 % étaient employés dans l'agriculture, 15 % dans l'industrie et 40 % dans les services.
AGRICULTURE ET FORESTERIE.
Sous les terres agricoles est d'env. un tiers de la superficie totale du pays. Dans le même temps, les terres les plus fertiles sont occupées par de grandes plantations de cultures d'exportation, et la majeure partie des exploitations (taille moyenne - 4 hectares) sont petites et incapables de nourrir les propriétaires, qui sont contraints de quitter la production ou d'être embauchés comme locataires. .
La principale culture agricole aux Philippines est le riz (collecte en 2002 - 13,3 millions de tonnes). Le maïs, qui occupe un tiers des terres arables. En 2002, 4,3 millions de tonnes de maïs ont été récoltées. Les Philippines sont d'importants producteurs d'ananas (pour l'exportation) et de bananes, ainsi que de sucre produit à partir de la canne à sucre (25,8 millions de tonnes - 2002). Le café (132,1 milliers de tonnes et 1,8% de sa production mondiale) et le caoutchouc naturel (73,3 milliers de tonnes, 12e place mondiale) sont d'une grande importance. Canne à sucre, cocotier, patate douce (pour répondre à la demande intérieure), hévéa, ramie, diverses cultures fruitières et maraîchères, agave, abaca (chanvre de manille) - fibre textile de bananier, à partir de laquelle sont fabriqués des cordes, des tapis, des nattes, sont également cultivés. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'une des plus grandes industries locales y était associée. Dans la période d'après-guerre, lorsque les matières synthétiques sont devenues à la mode, la demande d'abaca a considérablement diminué, mais elle est toujours exportée, quoique dans une moindre mesure. L'abaca est cultivé au sud de Luzon, dans les régions orientales des Visayas et à Mindanao.
Les Philippines cultivent du tabac à cigare de haute qualité depuis près de 200 ans. Depuis 1950, s'y est ajoutée la culture de variétés de tabac à cigarettes aromatiques, destinées principalement aux consommateurs domestiques. Les principales plantations de tabac sont situées au nord de Luzon.
Zones agricoles.
Il y a 10 zones agricoles dans les îles Philippines.
1.Ilocos - une région côtière densément peuplée au nord-ouest de Luzon, où le riz et le tabac sont cultivés. En saison des pluies, plus de 60% du coin cultivé est occupé par des cultures de riz ; en saison sèche, de nombreuses rizières sont réservées aux légumes et au tabac.
2. Vallée de la rivière Cagayan au nord-est de Luzon, qui a longtemps été considérée comme l'une des zones les plus favorables du pays pour la culture du tabac, du maïs et du riz.
3. La plaine centrale, au nord de Manille, est un grenier à riz et un important centre de culture de la canne à sucre.
4. Région sud tagalog au sud de Manille aux sols volcaniques fertiles, où se développe une agriculture tropicale diversifiée. Riz, cocotier, canne à sucre, café, toutes sortes de cultures fruitières et maraîchères y sont cultivées.
5. La vallée de la rivière Bicol dans le sud-est de Luzon, où la production agricole se spécialise dans la culture des cocotiers et du riz, dont la récolte dans de nombreuses régions est récoltée deux fois par an.
7. Visayas orientales. Les principaux produits d'exportation sont les produits du cocotier. La canne à sucre est cultivée pour le marché intérieur. Le maïs est la principale culture céréalière à Cebu, à l'est de Negros et dans certaines régions de Leyte, le riz prédomine sur les îles de Samar et Bohol et à l'est de Leyte.
7. Western Visayas, où le riz et la canne à sucre sont cultivés.
8. Les îles Mindoro et Palawan - une zone de colonisation agricole primaire.
9. Au nord et à l'est de Mindanao - la zone de culture du maïs et des cocotiers. La culture des ananas et l'élevage du bétail sont d'importance locale. 10. Le sud et l'ouest de Mindanao sont un chef de file dans le développement d'une économie de plantation diversifiée. Le cocotier, l'hévéa, le café, l'ananas, ainsi que le riz et le maïs y sont cultivés.
FORESTERIE ET PÊCHE.
Actuellement, les forêts occupent environ 40% du territoire des Philippines (en 1946 - plus de 50%). Selon les calculs des experts gouvernementaux en environnement, afin de maintenir la pérennité des écosystèmes, il faut que la superficie boisée soit d'au moins 54 %. Entre-temps, à la suite d'abattages intensifs, de vastes zones sont complètement dépourvues de couvert forestier. La foresterie reste l'une des industries les plus importantes, dont les produits (en particulier le bois de séquoia) jouent un rôle de premier plan dans les exportations.
Le poisson et le riz sont des aliments de base pour les Philippins. Environ la moitié des captures totales est fournie par les communautés traditionnelles de pêcheurs professionnels, un quart des captures provient des entreprises de pêche et un autre quart provient d'une aquaculture en plein développement. Un problème sérieux pour la pêche locale est la détérioration de l'environnement aquatique.
INDUSTRIE.
Les Philippines sont l'un des 10 premiers producteurs de chrome au monde. Parmi les minerais, on trouve l'or, le cuivre, le nickel, le fer, le plomb, le manganèse, l'argent, le zinc et le cobalt. Parmi les minéraux identifiés figurent le charbon, le calcaire, les matières premières pour l'industrie du ciment. Actuellement, seule une petite partie des gisements disponibles d'importance commerciale est exploitée. Le minerai de cuivre est extrait principalement sur l'île de Cebu et dans la partie sud de l'île de Negros ; or - au nord de Luzon et dans la partie nord-est de Mindanao; minerai de fer - sur l'île de Samar et au sud-est de Luzon; chromite - à l'ouest de Luzon et dans la partie nord de Mindanao; nickel - au nord-est de Mindanao ; charbon - sur l'île de Cebu et à l'ouest de Mindanao.
Un gisement de pétrole a été découvert au large de Palawan en 1961, et son développement commercial a commencé en 1979. Cependant, en 1993, seulement 2 % du pétrole consommé était produit aux Philippines.
Industrie manufacturière développée. La forte augmentation de la part des produits manufacturés dans les exportations - de moins de 10 % en 1970 à 75 % en 1993 - a fait de cette branche de l'économie la principale source de recettes en devises des Philippines. Les équipements électroniques et les vêtements occupaient une place particulièrement importante dans l'exportation. En outre, l'industrie philippine produit d'autres biens de consommation : aliments, boissons, produits en caoutchouc, chaussures, médicaments, peintures, contreplaqués et placages, papier et produits en papier, appareils électroménagers. Les entreprises de l'industrie lourde produisent du ciment, du verre, des produits chimiques, des engrais, des métaux ferreux et du pétrole raffiné.
Skype : poruchikag ou ag-5858
E-mail: